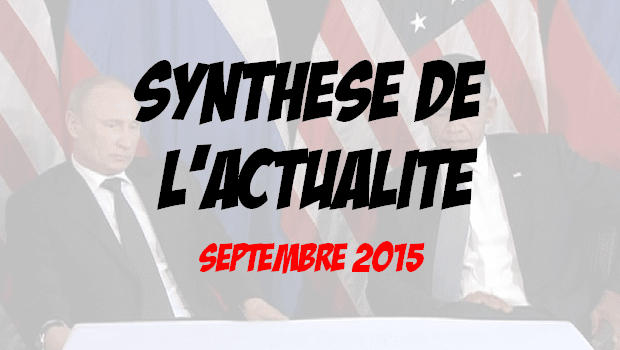Bon allez, cette fois il commence à faire froid, l’été est bel et bien fini. En conséquence, les synthèses d’actu Major-Prépa reprennent et vont t’offrir un vivier d’exemples et d’accroches pour tes dissertations tout au long de cette année plus (carré et cube) ou moins (bizuth) décisive.
Bonne lecture !
Limites de la gouvernance mondiale : l’impasse dans la définition d’une stratégie commune pour combattre l’OEI
En cette fin de mois de septembre, l’ouverture d’un « sommet antiterroriste » en marge de l’assemblée générale des Nations Unies fut des plus électriques. L’antagonisme porte sur la question de la légitimité du régime syrien à combattre l’OEI, aux côtés des autres nations engagés dans la lutte contre l’organisation terroriste. Les positions divergent selon les intérêts des Etats dans la région et s’agencent de la manière suivante :
- D’abord la coalition occidentale, emmenée par les Etats-Unis. Elle tente depuis plus d’un an de juguler l’avancée de Daech en Syrie et en Irak en bombardant les positions de l’organisation. Cette stratégie a montré ses limites ces derniers mois. Par ailleurs, les occidentaux dénoncent les exactions commises par Assad contre son propre peuple depuis le début de la guerre civile il y a quatre ans, et refuse de s’appuyer sur son régime pour combattre l’OEI. La position est claire : le départ d’Assad est une condition nécessaire au retour à la normale au Moyen-Orient
- Poutine ne voit pas les choses de cet œil : il entend maintenir coûte que coûte Assad au pouvoir, et la perspective de l’intégrer à la coalition contre Daech serait un premier pas décisif pour Moscou. La Russie est le seul pays d’influence à soutenir ouvertement le régime de Bachar, à l’exception de l’Iran qui se positionne ainsi à l’aune de la religion (Bachar al-Assad est un chiite alaouite). En revanche, d’aucuns jugent que les motivations russes sont bien d’ordre géopolitique : Poutine espère pouvoir, après l’éradication de l’OEI, se servir de ce gouvernement fantoche pour faire valoir ses intérêt au Moyen-Orient. Moscou a ainsi entrepris depuis la fin du mois de septembre des interventions aériennes en Syrie qui devraient, selon les propos du ministre des affaires étrangères Sergei Lavrov « se poursuivre trois à quatre mois en s’intensifiant ». Cette stratégie est fermement condamnée du coté occidental : le Kremlin considère les troupes de l’OEI et tous les opposants modérés au régime d’al-Assad comme des terroristes. A l’inverse, le PKK turque salue l’intervention russe, car Moscou devrait s’opposer à une intervention turque dans la région.
En somme, ce sommet antiterroriste a mis en lumière l’impossibilité d’une lutte internationale coordonnée : un ennemi commun certes, mais une multitude d’intérêts sous-jacents inconciliables au sein de la région. La question du nationalisme kurde, l’opposition sunnite-chiite ravivée, et enfin le maintien ou non du régime de Bachar al-Assad sont autant de clivages qui ne pourront certainement pas être surmontées.
Le scandale Volkswagen
La volonté de groupe allemand de prendre la place de Toyota en tant que n°1 mondial de l’automobile attendra. Le 18 septembre, un scandale de grande ampleur agit comme un (très) gros grain de sable dans la mécanique bien huilée de Volkswagen : des ingénieurs sont accusés par l’Agence américaine de protection de l’environnement d’avoir truqués des logiciels mesurant l’impact écologique du moteur. Rapidement les informations se recoupent et se précisent, et on découvre que le groupe Bosch a fourni ses logiciels à Volkswagen.
Si pour le moment les ventes du groupes ne semblent pas être impactées (rien qu’en France, les ventes de la marque ont bondi de 12,8% par rapport à septembre 2014), ce scandale sans précédent dans l’histoire de l’automobile a provoqué pêle-mêle la démission du PDG Martin Winterkorn, la chute de 40% de la valeur des actions du groupe à la bourse de Frankfort et l’ouverture de nombreuses enquêtes judiciaires. C’est le cas du parquet de Paris qui accuse Volkswagen de « tromperie aggravée sur une marchandise susceptible d’être dangereuse pour la santé ».
Au total, 11 millions de moteurs sont concernées. En plus des voitures de la marque Volkswagen, le scandale éclabousse les autres succursales du groupe (Seat, Skoda, Audi) mais dans une moindre proportion. Parmi ces onze millions d’automobiles, près d’un million ont été vendues en France.
Au-delà des pertes directes pour Volkswagen, c’est toute la « deutsche Qualität » qui pourrait pâtir de ce scandale, notamment l’image rigoureuse et déontologique qu’on associe généralement aux sociétés allemandes.
L’indépendance de la Catalogne : pourquoi on n’y croit pas?
Dimanche 27 septembre se sont tenues en Catalogne des élections législatives aux allures de référendum sur l’indépendance de la région. Celle-ci n’a jamais été souveraine, mais depuis quelques années des velléités nationalistes ont émergé jusqu’à porter à la tête de la région l’indépendantiste Artur Mas. C’est le rejet en 2010 d’un texte reconnaissant l’existence de la “nation catalane” ( lui octroyant de fait une plus grande autonomie) par le tribunal constitutionnel basé à Madrid qui a mis le feu aux poudres et entamé le divorce entre Barcelone et le pouvoir central.
Ces élections étaient donc bien le théâtre d’une opposition frontale entre les deux listes indépendantistes et les autres, entre deux conceptions de la Catalogne pour l’avenir. Pour un résultat des plus mitigés… Certes, les indépendantistes raflent 72 sièges, soient la majorité des sièges au parlement catalan. Néanmoins, ils n’obtiennent que 47,8% des suffrages, ce qui démontre qu’une courte majorité de Catalans reste hostile à la sécession avec l’Espagne. Les deux camps revendiquent ainsi la victoire, les premiers se déclarant investis d’une mission séparatiste par le peuple catalan, et les autres affirmant que la volonté d’union de l’Espagne reste préservée après le vote de dimanche.
Quelque soit l’interprétation que l’on fait du résultat, on ne peut que douter de l’aboutissement d’un tel projet, et ce pour plusieurs raisons : d’abord, la scission pure et simple entre la Catalogne et l’Espagne est anticonstitutionnel; l’article 2 parle de l’Espagne comme d’une nation “indivisible” même si elle reconnait le droit d’autonomie des régions. L’Espagne est en effet fortement décentralisée, et les “communautés autonomes” qui la constituent (Andalousie, Canaries, Galice…) jouissent d’un parlement, d’un gouvernement et même d’une police autonome.
Surtout, les motivations des Catalans sont bien moins culturelles qu’économiques : la Catalogne est la région la plus puissante d’Espagne. Elle rassemble 16% de la population espagnole et produit 20% des richesses du pays.
“ Avec Barcelone, la Catalogne possède un des plus grands ports commerciaux de la Méditerranée, quatre aéroports internationaux, une industrie pharmaceutique compétitive, et abrite les sièges de grandes multinationales, comme le géant du textile Mango. Le taux de chômage, certes élevé, reste en deçà de la moyenne nationale : il était au deuxième trimestre de 19,1 % de la population active, contre 22,4 % au niveau national.” Le Monde.fr (28/09/2015)
Les indépendantistes surfent donc sur le ras-le-bol des contribuables catalans qui estiment donner trop à l’Espagne (en particulier aux régions les plus en difficulté) comparativement à ce qu’ils reçoivent de l’Etat. D’après le calcul de la communauté autonome de Catalogne, le manque à gagner pour la région s’élève à 8,5% de son PIB. Madrid avance de son côté un chiffre deux fois plus faible (4,3% du PIB catalan).
Néanmoins, l’argument parait fallacieux lorsqu’on considère les réelles conséquences de l’indépendance de la Catalogne: elle impliquerait une sortie de l’Union européenne (comme l’a rappelé la porte parole de l’exécutif européen, une région qui fait sécession sera considérée par l’UE comme un pays tiers et devra faire une demande de candidature auprès de l’institution pour espérer l’intégrer).
A la clé, une résurgence des taxes douanières bien évidemment corrélée à une baisse des exportations et des délocalisations massives d’entreprises souhaitant accéder au marché unique. L’intérêt pour la Catalogne est donc discutable, d’autant que la région reste fragile, fortement endettée (à hauteur d’un tiers de son PIB). Elle ne peut se financer sur le marché et est tributaire de Madrid pour injecter de l’argent frais dans son économie.
De manière plus générale, et même si cette volonté d’indépendance a peu de chances d’aboutir tant elle semble suicidaire économiquement, le cas catalan est révélateur des effets de la mondialisation sur les territoires. Comme le fait remarquer François Bourguignon dans La mondialisation de l’inégalité, ce phénomène a certes réduit les écarts entre les différentes parties du monde, mais elle a aggravé des disparités économiques préexistantes à l’échelle des nations. Il en résulte des clivages de plus en plus forts, cristallisés autour de réflexes identitaires, et in fine une montée des mouvements séparatistes. Après l’Ecosse, la Catalogne devrait à son tour encourager ce type de revendications déjà très prégnantes en Europe (Lombardie, Flandre, Irlande du Nord…).
La question migratoire continue de diviser l’Europe
Ce grand feuilleton estival se poursuit en automne, avec toujours son lot de désaccords entre les Etats membres. Le 28 septembre, le sulfureux président hongrois Victor Orban a déclaré à la tribune de l’ONU que l’Europe ne peut soulever des attentes qu’elle ne peut combler seule, légitimant ainsi les murs que la Hongrie érige pour endiguer l’afflux de migrants syriens, afghans, irakiens… Après avoir fermé 175 km de frontières entre son pays et la Serbie, Orban pense désormais en faire autant le long de la frontière slovène et croate. Il a par ailleurs affirmé que cette vague migratoire « massive » n’est pas uniquement constituée de personnes fuyant la violence de leur pays natal, et que cet afflux alimente les réseaux criminels en tout genre. Orban a finalement conclu son discours en proposant un système de « quotas mondiaux » qui préserverait l’Europe d’une charge qu’il juge insupportable.
L’Europe courtise la Turquie
Du côté de Bruxelles, tous les regards se tournent vers Erdogan : l’Europe prend progressivement la mesure de ce qui est sans conteste le plus grand mouvement migratoire depuis la fin de la seconde guerre mondiale ; l’UE va devoir composer avec ses marges pour gérer cette crise majeure.
Selon le Haut-Commissariat aux Réfugiés (HCR), qui est un organisme onusien, 700 000 migrants devraient traverser la Méditerranée sur l’ensemble de l’année 2015, et au moins autant en 2016. La Turquie, de par sa position géographique, est en première ligne et commence à dénoncer la passivité de la communauté internationale : depuis 2011, elle a accueilli 2,2 millions de réfugiés syriens pour un coût total estimé à 7 milliards de dollars. La Turquie a financé seule 94% de cette somme.
Ankara s’impatiente et ne se dit plus en mesure de jouer le rôle de zone tampon de l’Europe. Elle réclame une aide directe des instances européennes. La marge de manœuvre de l’Europe dans ces négociations est faible, d’autant que les dirigeants européens espèrent imposer à la Turquie l’ouverture de centres d’accueils et d’enregistrements sur son territoire. Ces centres ont vocation à faire le tri entre les migrants économiques et ceux susceptibles d’obtenir l’asile politique en Europe.
Une des clés de ce bras de fer est l’abolition des visas vers l’UE pour tous les ressortissants turcs. Alors que l’adhésion de la Turquie à l’UE est un vieux serpent de mer européen, Ankara peine à accepter que les Serbes ou les Albanais puissent voyager librement à l’intérieur de l’Union alors que les Turcs ne le peuvent pas. A l’heure où l’UE cherche à se prémunir d’une vague migratoire trop importante, il n’est pas certain que les Etats-membres soient prêt à offrir un accès sans visa à 75 millions de Turcs.
Les matières premières poursuivent leur dégringolade
Conséquence directe des incertitudes sur la croissance chinoise, un coup de tonnerre a déchiré le ciel déjà agité de la finance mondiale début septembre: l’indice Bloomberg, qui agrège vingt-deux matières premières (agricoles et industrielles), a plongé en-dessous de son niveau de 2009, quand que le contrecoup de la crise des subprimes avait fortement ralenti la demande. Pire : il faut remonter à aout 1999 pour trouver trace d’un indice Bloomberg aussi faible. Du pétrole au cuivre en passant par le palladium (utilisé entre autres dans l’industrie automobile) la baisse ne semble épargner aucune denrée, à l’exception de l’or qui reste traditionnellement une valeur refuge.
Comment expliquer une chute aussi violente du cours des matières premières ? Elle tient effectivement en grande partie aux doutes des investisseurs quant à la vigueur de l’économie chinoise. De nombreux conjoncturistes ne croient plus que l’objectif officiel de Pékin établi à 7% de croissance en 2015 soit tenable. Cette méforme de la Chine pèse énormément sur les cours, puisque le pays absorbe à lui seul près de la moitié de la production mondiale.
Vu ces perspectives moroses, l’ensemble des entreprises exploitant ou spéculant sur les matières premières s’attendent à une traversée du désert économique, d’autant que la conjoncture ne leur permet pas d’envisager d’améliorations significatives des cours dans les mois à venir. La multinationale anglo-australienne BHP Billiton, premier groupe minier du monde, a ainsi annoncé une baisse spectaculaire de 86% de son bénéfice net annuel au cours de l’exercice qui s’est achevé fin juin. L’anglo-suisse Glencore et l’anglo-australien Rio Tinto (encore un !), les autres mastodontes du secteur, s’apprêtent également à passer une fin d’année peu réjouissante.
Et que dire du prix du pétrole qui, outre les déboires de la Chine, est tirée vers le bas par la forte hausse de l’offre ? Même si cette surabondance est purement conjoncturelle, elle semble partie pour durer : les pétromonarchies du golfe arabo-persique ne semblent pas décidées à ralentir leur production, tout comme les oil-men américains qui continuent du pomper frénétiquement leurs réserves d’hydrocarbure de schiste malgré une baisse de plus de 60% du prix de vente entre juin 2014 (115$ le baril) et aujourd’hui. Le baril de brent de la mer du Nord, qui sert de référence mondiale, a flirté avec les 43$, son plus bas niveau depuis mars 2009. Le trafic de l’or noir a par ailleurs pris une ampleur sans précédent à travers la planète, que ce soit au Moyen-Orient où il alimente Daech ou encore au Venezuela où il finance les réseaux criminels et le marché noir (plus de détails ici), ce qui contribue également à faire baisser les prix.
N’en déplaise à Total, Shell et autre BP, mais le retour du brut iranien sur les marchés mondiaux prévu pour 2016 ne devrait guère amorcer une remontée prochaine les prix…