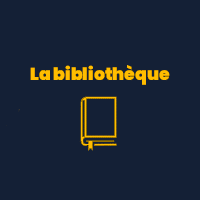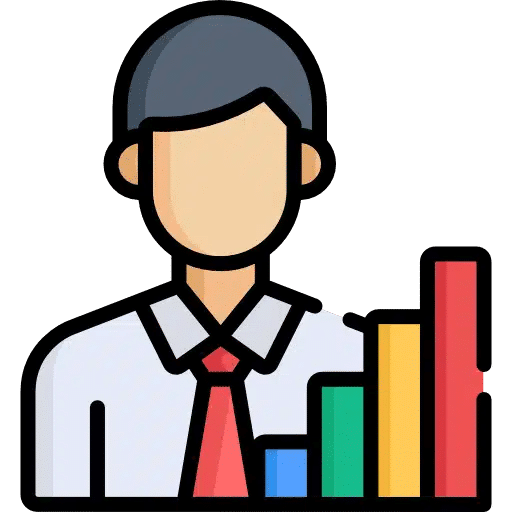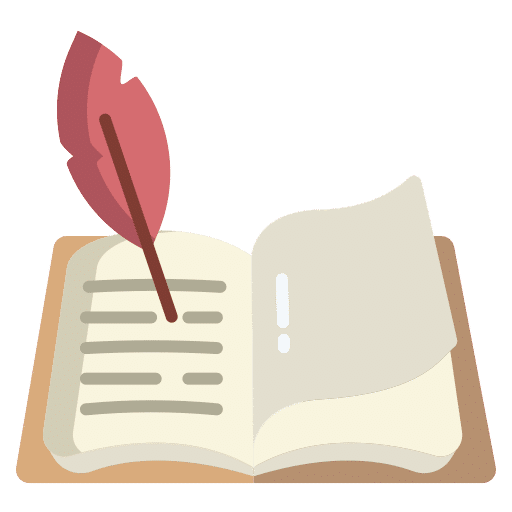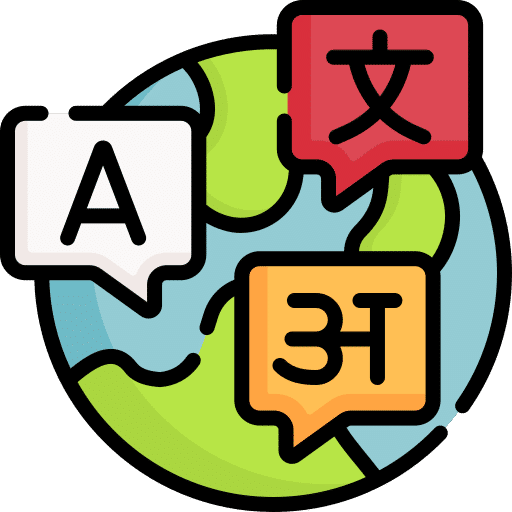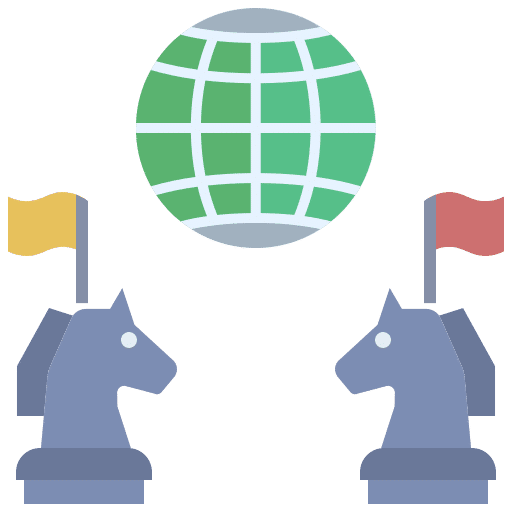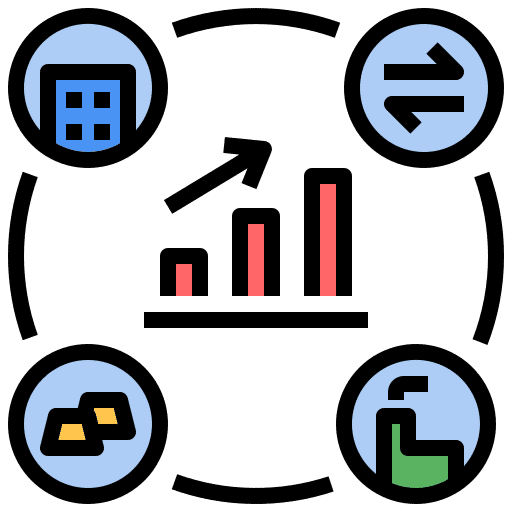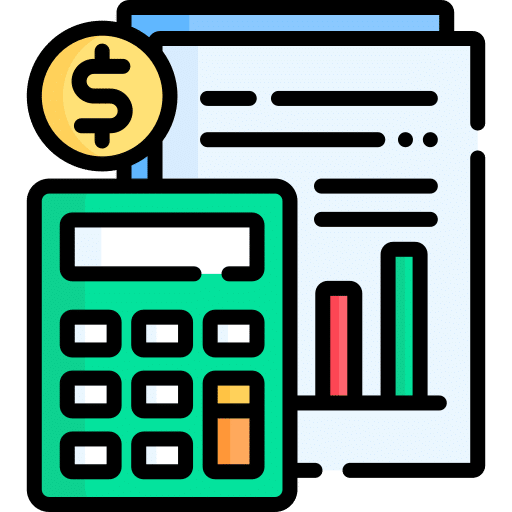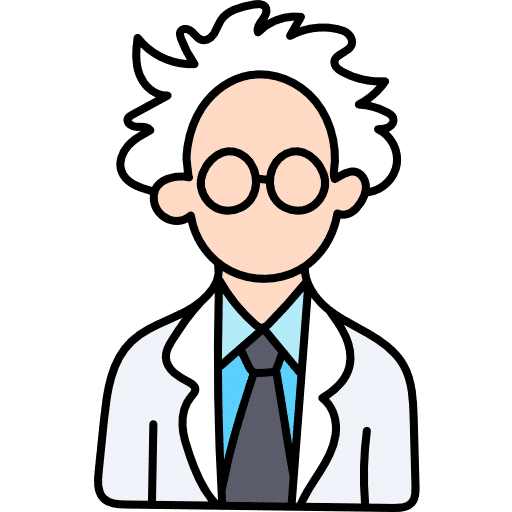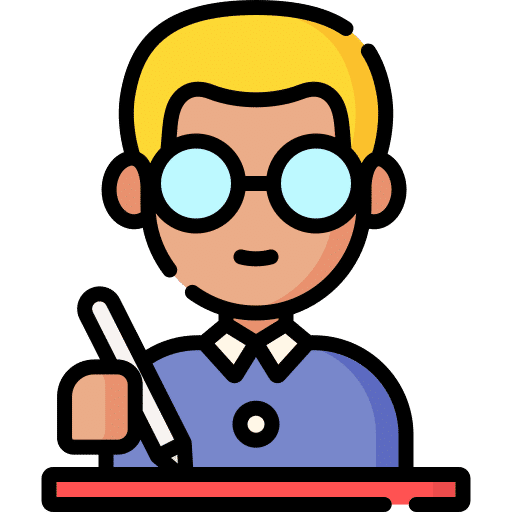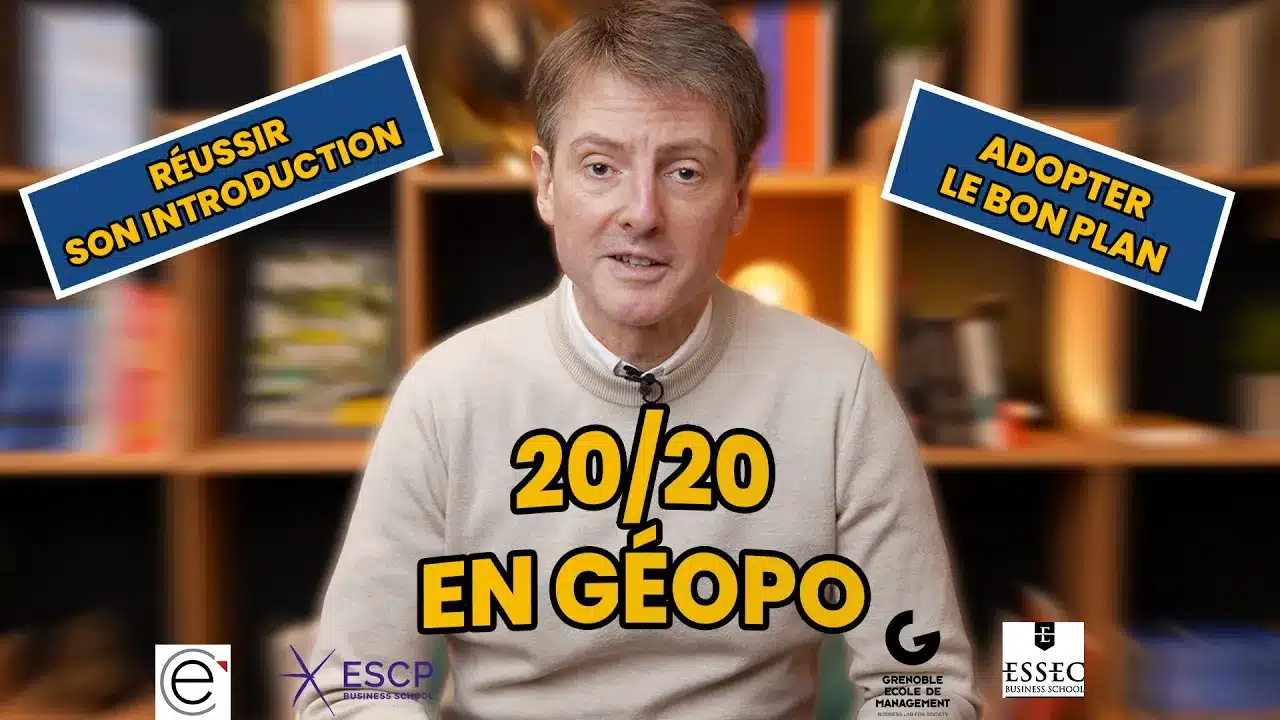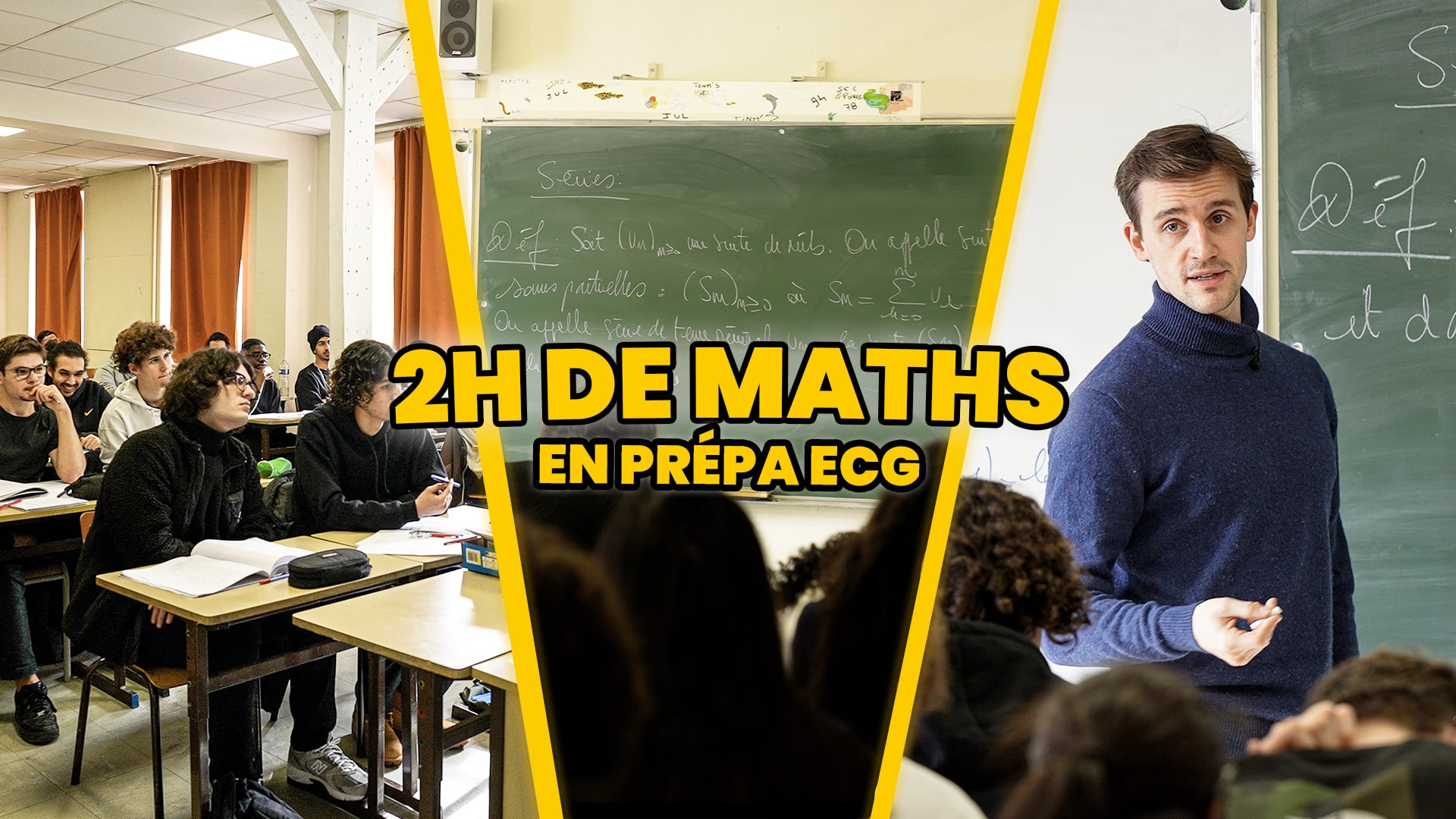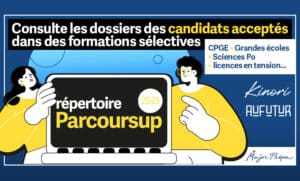Toutes nos ressources pour réussir les concours !
Abonne-toi à la newsletter Major Prépa !
Chaque vendredi dans ta boîte mail, un résumé de l’actu prépa & concours, des conseils méthodo et nos meilleurs contenus pour réviser dans toutes les matières !