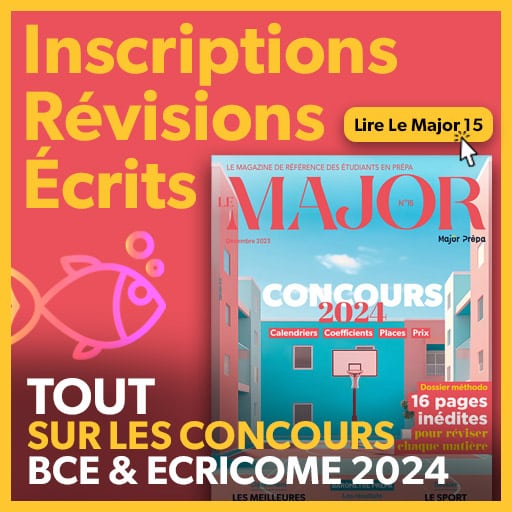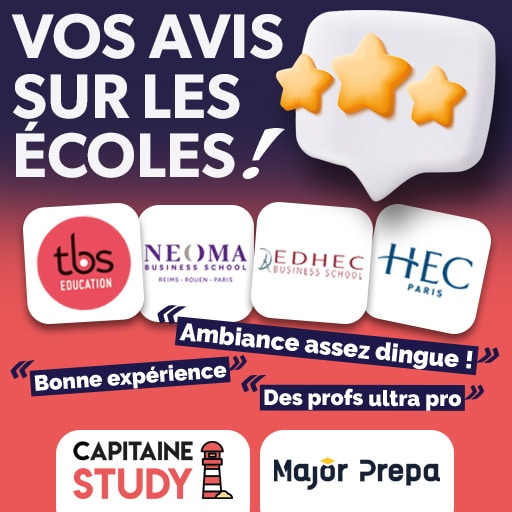Dans cet article, nous nous intéressons au plaidoyer du philosophe Tom Regan pour l’attribution de droits moraux aux animaux.
Quelques mots sur Regan et son article
Regan est un philosophe analytique américain du XXe siècle, spécialisé dans l’éthique animale.
Le texte que nous allons étudier est l’article « The Rights of humans and other animals » publié en 1986.
Le thème
Le thème de ce texte est l’éthique animale.
La question
Regan se pose la question suivante : la notion de droit moral est-elle philosophiquement appropriée pour défendre les animaux ?
Les enjeux
Pour bien comprendre l’intérêt de la question, il faut saisir ses enjeux. Regan cherche ici à contester le paradigme utilitariste dominant. Ce dernier, selon lui, est trop perméable à la maltraitance animale : Regan souhaite abolir complètement l’exploitation animale et accuse l’utilitarisme de ne mener à cet égard qu’à un réformisme timide et insuffisant.
La thèse
La thèse de Regan est que la défense des animaux est assurée de façon optimale par l’attribution à ces derniers de droits moraux indiscutables.
Le plan du texte
Regan commence par souligner les avantages d’une défense des êtres humains en termes de droit moral.
Il considère ensuite, pour en faire la critique, la position morale utilitariste, qui s’appuie au contraire sur la notion de bien-être.
Regan expose finalement les conclusions qu’on peut tirer des parties précédentes sur l’éthique animale : il faut défendre les animaux en leur attribuant des droits moraux.
I – Les droits moraux et l’homme
1) Qu’est-ce qu’un droit moral ?
Il convient de préciser d’emblée que l’article de Regan porte non pas sur les droits juridiques, mais sur les droits moraux. L’article relève uniquement de la philosophie éthique. Le terme de « droit » renvoie donc toujours à la notion de droit moral.
Regan définit cette dernière comme suit :
Human rights place justified limits on what people are free to do to one another.
[Les droits humains posent des limites justifiées concernant ce que les gens peuvent se faire les uns aux autres.]
Autrement dit, attribuer un droit à tel individu, c’est considérer que certaines actions le concernant sont absolument interdites.
2) L’expérience de pensée du vieux joueur de baseball
Regan propose une expérience de pensée simple pour mieux faire comprendre ce qu’impliquent des droits moraux : imaginons qu’il y ait d’une part un vieux joueur de baseball à la retraite, mais en excellente santé, et d’autre part trois joueurs de baseball en activité mais possédant chacun un organe gravement défaillant. On peut admettre, factuellement, que tuer le vieux joueur contre sa volonté pour guérir les trois autres apporterait globalement plus de bien-être dans le monde : les jeunes joueurs seraient guéris et ils pourraient continuer à divertir des millions d’individus. Mais est-ce moralement acceptable ?
La réponse de la théorie du droit moral est que non : le vieux joueur a un droit absolu à l’intégrité physique ; par conséquent, on ne peut lui porter atteinte physiquement même s’il doit en résulter globalement plus d’avantages que d’inconvénients.
II – Critique de la morale utilitariste
1) L’utilitarisme est un conséquentialisme
Contrairement à la position de Regan, qu’on peut appeler déontologique (du grec déon-, « ce qui convient »), la position utilitariste repose non pas sur la prise en compte des droits, mais sur la prise en compte des conséquences d’une action. L’utilitariste rejette une action non parce qu’elle viole certains droits, mais parce qu’elle aboutit à des conséquences globalement moins bonnes que l’état actuel des choses.
2) L’utilitarisme et l’agrégation des expériences
Une deuxième caractéristique importante de l’utilitarisme est qu’il prend en compte les expériences des individus pris collectivement, et non individuellement. C’est la quantité totale de bien-être qui intéresse l’utilitariste. Cela signifie qu’il admet en principe qu’on puisse sacrifier le bien-être d’un ou plusieurs individus s’il en résulte une plus grande quantité de bien-être pour la collectivité.
3) L’utilitarisme et le vieux joueur de baseball
Pour comprendre ce que la position utilitariste peut avoir de problématique, il faut revenir sur l’expérience de pensée du vieux joueur de baseball. L’utilitariste peut y répondre de deux manières différentes.
La première consiste à contester l’affirmation factuelle selon laquelle le sacrifice du vieux joueur apportera un bien-être général supérieur. Il faudra alors montrer qu’en réalité, si l’on prend la totalité des conséquences en compte, ce sacrifice n’est pas avantageux. C’est ce qu’on appelle l’utilitarian shuffle ou mélange utilitariste.
Mais si le sacrifice est effectivement profitable à la collectivité, la seule possibilité qui reste à l’utilitariste est celle qu’on peut appeler bite the bullet ou serrer les dents : même si c’est désagréable, il faut accepter de sacrifier le vieux joueur.
Ce qu’il faut retenir de ces considérations, c’est que l’utilitariste n’interdit pas en principe qu’on porte gravement atteinte à un individu, même si un tel geste est conditionné à l’augmentation du bien-être général.
4) La supériorité de la théorie du droit moral
Pour Regan, ce cas simple montre la supériorité de la théorie du droit moral sur la théorie utilitariste. Elle permet en effet de rendre impossible ce genre de situations moralement inacceptables en attribuant des droits absolus à l’individu. Ces droits absolus signifient qu’il y a des choses qu’on ne peut tout simplement pas faire à quelqu’un, quels que soient les avantages qui pourraient en découler pour la collectivité.
III – Les droits moraux et l’animal
1) Welfaristes et déontologistes
Sur la base des considérations précédentes, nous pouvons examiner le cas des animaux. Regan distingue, parmi ceux qui se soucient du sort des animaux, deux catégories : les welfaristes (qui sont ici assimilés aux utilitaristes), qui refusent que des souffrances gratuites soient infligées aux animaux, et les déontologistes, qui attribuent des droits absolus aux animaux, au sens défini précédemment.
2) Réformisme et abolitionnisme
Ces positions philosophiques recoupent plus ou moins deux positions politiques concernant la question animale : les welfaristes se situent plutôt du côté du réformisme, au sens où ils essaient d’améliorer les conditions dans lesquelles les animaux sont exploités ; les déontologistes, au contraire, se situent plutôt du côté de ce qu’on appelle l’abolitionnisme : ils veulent supprimer toute exploitation animale.
Il faut comprendre le fondement de cette différence dans les visées politiques des deux camps. Si les welfaristes sont réformistes, c’est parce qu’ils ne condamnent pas par principe l’exploitation animale. Selon la logique utilitariste, ils peuvent tout à fait accepter qu’on exploite un animal s’il en résulte un bien-être général supérieur, la collectivité prise en compte étant ici à la fois l’humanité et l’ensemble des animaux.
Si, au contraire, les déontologistes sont abolitionnistes, c’est parce qu’ils considèrent que les animaux ont des droits, et que l’exploitation animale est une violation de ces droits, quels que soient les avantages globaux qui pourraient en découler par ailleurs.
3) Fonder les droits des animaux : les caractéristiques pertinentes
Mais sur quoi les déontologistes se fondent-ils pour attribuer des droits aux animaux ? Pour le comprendre, il faut d’abord comprendre la démarche qui mène à attribuer des droits aux êtres humains. Quand nous voulons justifier que les hommes ont des droits, nous cherchons une caractéristique qu’ils possèdent et qui fonde ces droits. Ce peut être par exemple le fait qu’ils possèdent une âme, ou le fait qu’ils soient rationnellement autonomes. Le problème consiste bien évidemment à trouver une caractéristique pertinente : il faut que la caractéristique présentée soit un fondement valable des droits, et non une caractéristique choisie au hasard (comme le fait d’être bipède).
4) Cohérence philosophique et conséquences morales : des droits humains aux droits animaux
Bien sûr, une fois la caractéristique identifiée, il faut l’appliquer avec cohérence et impartialité. Cela signifie qu’on doit attribuer des droits à tous les êtres qui possèdent effectivement cette caractéristique, sans discrimination arbitraire. Nous allons voir que cette exigence de cohérence doit mener à la reconnaissance des droits animaux.
5) Un critère exigeant : l’autonomie rationnelle ; un critère faible : la sentience
Imaginons qu’on choisisse le critère de l’autonomie rationnelle et vérifions si ce choix aboutit à des conséquences moralement acceptables. Le problème qui se pose alors est celui des cas marginaux : il faudra refuser tout droit moral aux hommes dépourvus de cette caractéristique, comme les bébés, les déficients intellectuels graves, etc. Or ces conséquences semblent moralement inacceptables. Pour remédier au problème, il faut trouver un critère plus généreux. On peut imaginer celui de la sentience, c’est-à-dire la capacité à expérimenter plaisir et douleur. Dans ce cas, on peut attribuer un droit moral aux bébés et aux déficients intellectuels graves. Le défaut du critère précédent est donc corrigé. Mais, en vertu de l’exigence de cohérence, il faudra alors attribuer des droits à tous les êtres possédant la caractéristique de la sentience, qu’ils soient humains ou non. Beaucoup d’animaux se verront donc attribuer des droits moraux, car ils possèdent incontestablement cette caractéristique.
6) La nécessité d’attribuer des droits moraux aux animaux
Selon Regan, tous les critères qui incluent l’intégralité des êtres humains (y compris les bébés et les déficients) incluent aussi dans une très grande mesure les animaux. Comme il nous faut nécessairement inclure tous les êtres humains pour éviter des actions évidemment inacceptables, il nous faut nécessairement, aussi, reconnaître les droits moraux des animaux. Autrement dit, la cohérence intellectuelle va de pair avec la reconnaissance du droit moral des animaux. D’où la conclusion abolitionniste de Regan : it is not larger cages, it is empty cages that recognition of animal rights requires.
[La reconnaissance des droits animaux exige non pas des cages plus grandes, mais des cages vides.]
À retenir
L’utilitarisme est la théorie qui fonde l’éthique sur la notion de bien-être. Il autorise en principe le sacrifice du bien-être d’un ou plusieurs individus au bien-être collectif.
Le déontologisme défendu par Regan comme alternative à l’utilitarisme est la théorie qui fonde l’éthique sur la notion de droit moral. L’attribution d’un droit moral à un individu consiste à poser des limites absolues aux actions dont il peut faire l’objet.
Le déontologisme mène logiquement à la reconnaissance des droits des animaux. En effet, toute caractéristique pertinente justifiant les droits humains sera également possédée par la plupart des animaux, et justifiera donc les droits animaux.
NOS AUTRES ARTICLES ICI 😉