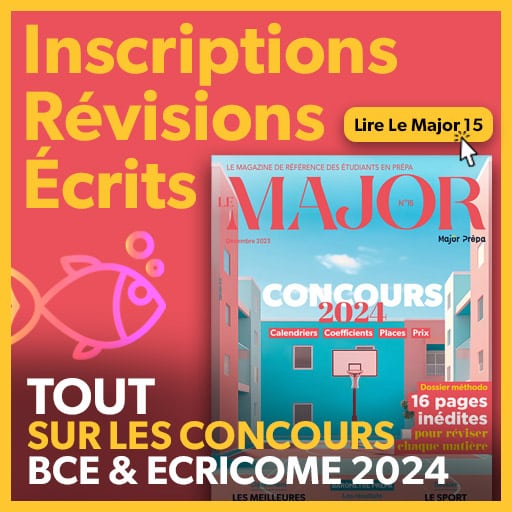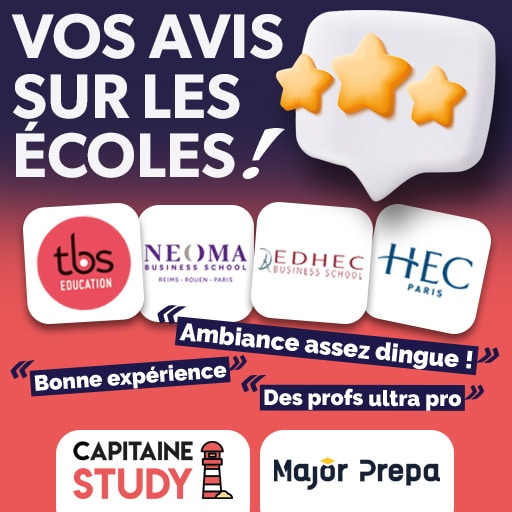Dans cet article, nous nous penchons sur ce qui, selon Rousseau, fait la spécificité de l’homme par rapport à l’animal.
Quelques mots sur Rousseau et son livre
Le texte que nous allons étudier se trouve dans le célèbre Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes (Première partie, de « je ne vois dans tout animal… » jusqu’à « …plus bas que la bête même »).
Dans ce livre, Rousseau se donne pour tâche de produire une généalogie de l’inégalité. Pour ce faire, il expose une histoire hypothétique de l’homme, qui serait passé à l’état civil à partir d’un état naturel originel.
Le thème
Le thème de ce texte est la différence entre l’homme et l’animal.
La question
Rousseau se pose la question suivante : quelle est la propriété qui distingue l’homme des autres animaux ?
Les enjeux
Pour bien comprendre l’intérêt de la question, il faut saisir ses enjeux. Rousseau vise ici trois objectifs différents : premièrement, il souhaite attribuer à l’homme une spécificité qui fasse de lui un être unique dans le monde naturel ; deuxièmement, il vise à exonérer Dieu des péchés des homme en conférant à ce dernier une liberté qui le rende responsable de ses actes ; troisièmement enfin, dans la perspective de sa généalogie de l’inégalité, il tente de montrer que la liberté explique que l’homme soit sorti de son état naturel pour entrer dans une histoire.
La thèse
Rousseau soutient que cette spécificité qui distingue l’homme de l’animal est la liberté, ou, comme on le verra, la perfectibilité.
Le plan du texte
Rousseau commence par présenter sa thèse (la spécificité de l’homme est la liberté) et ses conséquences sur la vie humaine : l’homme peut s’écarter de la nature.
Il disqualifie ensuite une autre propriété dans laquelle on pourrait reconnaître une spécificité de l’homme : l’intelligence. En réalité, les animaux possèdent aussi cette propriété.
Enfin, Rousseau soutient qu’une autre spécificité de l’homme est absolument indéniable : sa perfectibilité, c’est-à-dire la capacité qu’il possède de s’améliorer au cours du temps.
I – Animal = instinct, homme = liberté
1) L’animal est une machine
Le texte s’ouvre sur l’affirmation suivante :
Je ne vois dans tout animal qu’une machine ingénieuse
Deux choses importantes sont à remarquer. La première, c’est qu’en dépit de la formulation de Rousseau, il faut se garder d’assimiler complètement cette idée à la théorie cartésienne de l’animal machine. En effet, il existe sur ce point une différence cruciale entre Descartes et Rousseau : ce dernier reconnaît sans problème l’existence d’une d’une capacité de douleur et de plaisir chez l’animal, tandis que la théorie cartésienne est célèbre notamment pour avoir refusé une telle capacité à l’animal.
La deuxième remarque importante est que l’animal, pour Rousseau, demeure néanmoins assimilable à une machine dans son fonctionnement. En effet, les « sens » possédés par l’animal ne sont que des moyens réglés par la nature pour assurer son autoconservation. Le texte de Rousseau est elliptique, mais il faut comprendre ici que les informations sensibles véhiculés dans l’esprit des animaux par leurs organes des sens déclenchent en eux des réactions nécessaires déterminées par des lois : l’animal qui perçoit la nourriture qui lui est adaptée meut ses membres dans sa direction pour la consommer, et ce avec la nécessité qui régit les opérations d’une machine.
2) L’homme est une machine libre
Le fonctionnement de l’être humain est différent :
la nature seule fait tout dans les opérations de la bête, au lieu que l’homme concourt aux siennes, en qualité d’agent libre
Selon Rousseau, l’homme n’est ni radicalement différent de l’animal, ni absolument identique à lui. Il le qualifie en effet de « machine humaine », suggérant par là que le fonctionnement de l’être humain ressemble dans une certaine mesure à celui de l’être animal : tous deux sont des machines. Mais qu’est-ce qui distingue ces deux machines ? Ce sont les lignes suivantes qui donnent la réponse à cette question :
L’un choisit ou rejette par instinct, et l’autre par un acte de liberté
Celui qui « choisit par instinct » est bien sûr l’animal. Cela signifie qu’il réagit aux informations sensibles selon une règle immuable fixée par la nature. Ainsi, quand il est inscrit dans ce qu’on peut appeler le « logiciel » de tel animal, c’est-à-dire son système d’instincts, qu’il n’est pas attiré par les fruits, cet animal ne consommera jamais de fruits, même s’il s’agit du seul aliment disponible permettant de lui éviter une mort d’inanition.
La spécificité de l’homme est au contraire qu’il n’est pas limité par un tel « logiciel » ou système d’instincts. Comme l’animal, l’homme reçoit des informations sensibles, il perçoit par exemple la présence de tels aliments ; mais contrairement à l’animal, il choisit de les consommer ou non par un acte qui vient de lui-même et n’est pas réductible à l’instinct naturel. Comme Rousseau l’écrit dans le paragraphe suivant :
La nature commande à tout animal, et la bête obéit. L’homme éprouve la même impression, mais il se reconnaît libre d’acquiescer, ou de résister
Là où l’animal suit sans exception possible l’impulsion de l’instinct, l’homme choisit librement de le suivre ou non. Cette faculté du choix libre, qui se distingue de l’instinct, est ce que Rousseau appelle la « volonté ».
3) Conséquences de la liberté
De la liberté découle une conséquence importante au niveau des possibilités de la vie humaine : l’homme peut s’écarter de la nature, et surtout s’en écarter « à son préjudice », c’est-à-dire dans une direction qui lui nuit ou qui est moralement condamnable. C’est la liberté qui explique que l’homme, contrairement à l’animal, peut s’autodétruire ou pécher.
II – L’intelligence, commune à l’homme et à l’animal
1) Une différence de degré et non de nature
Dans cette deuxième partie de l’extrait étudié, Rousseau souhaite montrer que, contrairement à une thèse classique en philosophie, ce n’est pas l’intelligence qui distingue l’homme de l’animal. Il n’y a sur ce point, entre ces deux êtres, qu’une différence de degré, et non une différence de nature. Autrement dit, tous deux possèdent l’intelligence, quoique l’homme la possède sous une forme plus haute.
2) Lois psychologiques, lois physiques
Si Rousseau attribue volontiers la pensée à l’animal, c’est parce qu’il réduit cette dernière à une faculté naturelle comme les autres, et notamment comme le mouvement. Pour Rousseau, l’acquisition des idées et leur combinaison dans l’esprit, qui est la pensée, s’expliquent comme les mouvements physiques par les lois de la mécanique. Les phénomènes psychologiques obéissent eux aussi à la nature entendue au sens large comme étant l’ensemble des lois qui régissent les phénomènes. Il y a des lois psychologiques de la pensée comme il y a des lois physiques du mouvement.
3) Le naturel et le spirituel
Ce qui échappe en revanche totalement à la loi naturelle, et relève par conséquent proprement du domaine spirituel, c’est la liberté : son essence même est justement de se soustraire à la causalité naturelle, d’y faire irruption pour en modifier le cours.
La différence entre l’homme et l’animal ne se situe donc pas dans le fait que l’un posséderait une faculté naturelle que l’autre ne posséderait pas ; elle se situe à un niveau beaucoup plus fondamental, à savoir dans le fait que l’homme seul possède la faculté proprement surnaturelle d’agir en dehors de toute loi. C’est cette « surnaturalité » qui fait la spécificité de l’homme.
III – La perfectibilité humaine et l’immutabilité animale
1) L’évidente perfectibilité de l’homme
Nous venons de voir que Rousseau reconnaissait dans la liberté la spécificité de l’homme par rapport à l’animal, et considérait au contraire que l’intelligence était commune aux deux. Dans cette troisième partie de l’extrait, nous étudions le cas d’une troisième faculté, la perfectibilité. Il s’agit de la capacité qu’a l’homme de s’améliorer au cours du temps. Rousseau considère qu’il s’agit d’une autre spécificité de l’homme, à côté de la liberté.
Mais ce qui est particulier à cette faculté, c’est qu’elle est, pour sa part, absolument indéniable. La liberté est une faculté métaphysique et donc invisible : il n’est pas possible de l’observer empiriquement. La perfectibilité, au contraire, est une évidence sensible.
2) Perfectibilité de l’individu, perfectibilité de l’humanité
La perfectibilité humaine existe à deux niveaux : premièrement, au niveau de l’individu, qui se perfectionne constamment au cours de son existence ; secondement, au niveau de l’humanité, qui elle aussi évolue depuis son apparition sur terre.
Il faut distinguer la perfectibilité de la maturation. Bien sûr, l’individu animal évolue lui aussi au cours de son existence. Mais ce n’est qu’un processus de maturation biologique très provisoire : il évolue enfant pour prendre une forme fixe et définitive à l’âge adulte. L’homme au contraire continue à se perfectionner même après avoir atteint la maturité biologique (par exemple en apprenant à jouer d’un instrument de musique, en développant ses connaissances scientifiques, en apprenant à pratiquer un sport, etc.).
Rousseau (qui écrit avant le XIXe siècle et donc avant Darwin) attribue la même fixité aux espèces animales : celles-ci demeurent identiques à travers les siècles et les millénaires, tandis que l’humanité existe dans une histoire dont les prémices n’ont plus rien à avoir avec l’état présent : du paléolithique à aujourd’hui, l’espèce humaine a connu un progrès immense.
À retenir :
L’homme et l’animal sont des machines, au sens où ils fonctionnent tous deux conformément à des lois naturelles.
Mais l’homme est une machine libre : il peut décider de se soumettre ou non à ce que la nature lui commande.
Cette émancipation lui permet de s’élever au-dessus de la nature, mais l’expose également au risque de déchoir en-dessous d’elle, d’où la possibilité du péché qui n’existe pas chez l’animal.
L’intelligence, en revanche, existe chez l’homme comme des l’animal, et ne diffère de l’un à l’autre qu’en degré.
La perfectibilité enfin est une autre spécificité de l’homme : l’homme individuel, aussi bien que l’humanité, connaissent le progrès, là où les animaux demeurent immuablement les mêmes.
NOS AUTRES ARTICLES ICI 😉