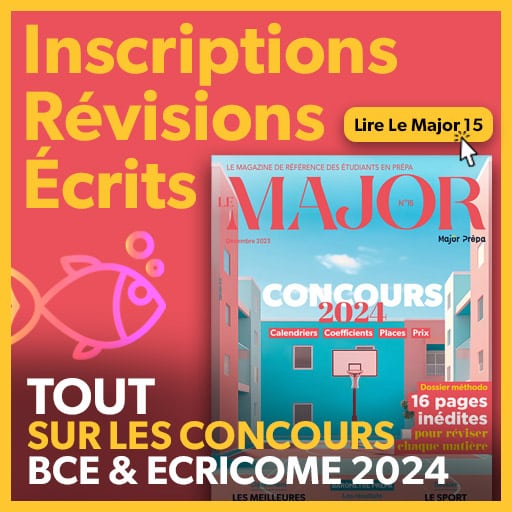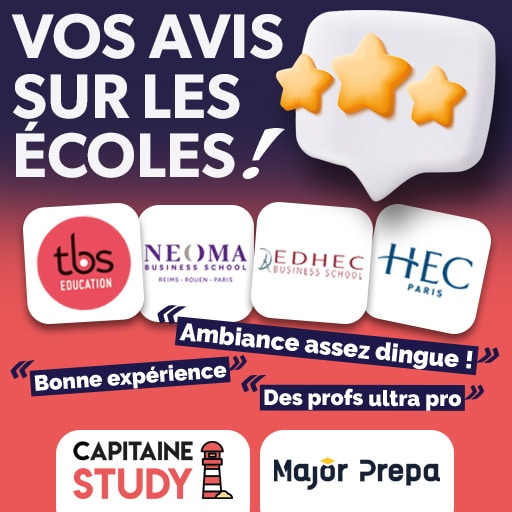Les Arméniens les reconnaissent à leur son strident, signe d’un danger imminent : les drones « Harpy », utilisés par l’Azerbaïdjan dans le conflit qui a opposé les deux pays en septembre 2020 dans le Haut-Karabakh, ont inauguré une nouvelle forme d’affrontement. À la formule de Clausewitz, où la guerre était la « continuation de la politique par d’autres moyens », se sont agrégés d’autres enjeux (technologie, nucléaire…) qui nous invitent à penser le concept de « guerre » à travers une dimension plus complexe. Quelles formes prennent les guerres d’aujourd’hui ?
Si, selon l’ONU, depuis 1946 le nombre de victimes a fortement diminué, on assiste paradoxalement à une recrudescence des conflits. Dès lors, l’espoir d’une paix universelle sous-entendue à la fin de la guerre froide semble se dissiper derrière l’incertitude du « brouillard de la guerre » clausewitzien. Imprévisible et incertaine, la définir n’est pas si facile : il conviendra, au lieu de faire une liste exhaustive de conflits, de donner quelques pistes de réflexion sur ce concept géopolitique.
Les mutations marquantes de la guerre
« Les guerres d’aujourd’hui sont-elles les guerres d’hier ? » était le sujet de dissertation Ecricome en 2017. Si certains conflits, en prise à des rivalités anciennes, s’inscrivent dans une continuité historique, les mutations sont nombreuses.
La première concerne le nucléaire : arme destinée avant tout à la dissuasion, elle bouleverse les logiques classiques de conflictualité, amenant certaines puissances à se lancer dans une course aux armements. Pour preuve, le 19 juillet 2021, la Russie teste avec succès son nouveau missile hypersonique Zircon. La maîtrise de cette technologie assure à Moscou une suprématie stratégique qu’elle n’hésite pas à afficher lors de puissantes démonstrations de force.
La deuxième est technologique. La révolution numérique a eu une double conséquence : l’utilisation croissante de technologies à des fins militaires et l’émergence d’un nouveau champ de bataille, désormais virtuel. Une guerre silencieuse mais omniprésente : à titre d’exemple, en 2018, le commandement de la cyberdéfense (France) recensait deux attaques par jour, soit des chiffres 20 % supérieurs aux chiffres de 2017. De la même manière, la modernisation de l’arsenal militaire change les règles du jeu. Qu’ils soient utilisés pour le renseignement ou pour le combat, les drones sont des armes révolutionnaires qui posent cependant un problème éthique (vis-à-vis de la convention de Genève).
En outre, l’émergence du terrorisme et d’un « djihadisme de 3e génération » (Gilles Kepel), sans frontières, redessine les cartes des conflits.
Les théâtres des guerres d’aujourd’hui
Dans quels espaces observe-t-on une concentration de « conflits » ? Selon le « SIPRI Yearbook 2021 », analysant les données de l’année 2020, 39 États ont subi, cette année-là, des conflits armés, soit 7 de plus que l’année précédente. Voilà donc la répartition des conflits que les continents : deux en Amérique, sept en Asie et Océanie, trois en Europe, sept au Moyen-Orient en Afrique du Nord et 20 en Afrique subsaharienne. De fait, en comparant les chiffres de 2019 avec ceux de 2020, on remarque que l’Europe est le théâtre de 2 nouveaux conflits et l’Afrique subsaharienne de 5 nouveaux conflits. De plus, le Moyen-Orient et l’Afrique semblent à eux seuls concentrer une grande partie des conflits mondiaux. Sous fond de bataille idéologique et d’intérêts géoéconomiques (hydrocarbures), les puissances régionales comme internationales se sont au MENA emparées de ces enjeux. Le tout formant pour les États-Unis un « arc des crises » (Brzezinski), qui s’étend pour la France de la Mauritanie jusqu’en Afghanistan.
Il est d’autant plus difficile d’identifier les zones géographiques que certains groupes armés opèrent dans une logique transnationale (terrorisme). Les théâtres de confrontations sont multiples : air, terre, mer, cyberespace, l’espace extra-atmosphérique. C’est la raison pour laquelle le Président Trump, en 2019, a lancé la « United Nations Space Force » dans un souci de militarisation de l’espace, tendance qui semble héritée de la guerre froide.

Typologie des guerres d’aujourd’hui
Conflits de longue durée ou « gelés »
Certains conflits sont paralysés par des contentieux historiques, idéologiques ou ethniques si bien que leur résolution à long terme semble impossible. Ce peut être à la suite d’une revendication territoriale (Cachemire, Cisjordanie) ou d’une partition (Inde-Pakistan). Si la confrontation militaire n’est pas permanente, l’actualité recense de manière récurrente des épisodes d’escalades puis de détentes, le tout ponctué par des cessez-le-feu. Malgré les tentatives américaines d’apaisement (accord d’Oslo, plan de paix), le conflit israélo-palestinien semble s’éterniser d’autant plus que l’on observe une radicalisation dans les deux camps. Preuve en est : en mai 2021, les tensions religieuses exacerbées à Jérusalem a donné lieu à 11 jours d’un conflit sanglant.
Après la chute de l’URSS, l’accès rapide à l’indépendance de certaines régions comme la Moldavie, l’Azerbaïdjan et la Géorgie a engendré des conflits internes dont la résolution n’est qu’apparente. En effet, les frontières ne correspondent pas à des réalités ethniques ou religieuses. On parle ainsi pour l’ex-URSS de « conflits gelés », conflits où les négociations sont dans une impasse. En ce sens, le conflit du Haut-Karabakh gelé depuis 1994 (même si des tensions subsistaient) a resurgi le 27 septembre 2020 dans cette région autonome de l’Azerbaïdjan peuplé majoritairement d’Arméniens.
Guerres interétatiques versus intraétatiques
On relève en 2020 deux conflits armés entre États (affrontements frontaliers entre l’Inde et le Pakistan et entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie) sur les 39. Le constat est clair : les guerres interétatiques semblent s’effacer derrière des conflits intraétatiques, hybrides, marqués par une diversification croissante des acteurs. Ces derniers opposent des forces gouvernementales et des groupes non étatiques (Afghanistan, Yémen, Syrie, Mexique, Nigeria, Irak…). À ce propos, certains, à l’instar du général Vincent Desportes, y voient le retour aux guerres préwestphaliennes, période avant 1648 (traités de Westphalie), où l’État n’était pas le principal acteur des conflits.
Les guerres d’aujourd’hui : le cas des guerres asymétriques
Après les attaques du 11 septembre, les États-Unis, avec à sa tête le Président Bush, se lancent dans une « guerre globale contre la terreur », guerre qui va brusquement prendre une forme asymétrique face à de nouvelles menaces, dont le terrorisme. La forte immixtion étrangère au Moyen-Orient témoigne de cette réalité : guerre en Syrie (Russie, États-Unis avec un soutien aux milices kurdes), Afghanistan (États-Unis, Russie, Chine). Les pertes sont lourdes pour certaines nations. En ce sens, Donald Trump déclarait en 2019 que près de 8 000 milliards de dollars avaient été « stupidement gaspillés » au Moyen-Orient.
Selon Jonathan B. Tucker, « la guerre asymétrique consiste à tirer parti de la faiblesse de l’adversaire en recourant à des armes et à des tactiques innovatrices ». Dans ce type de conflit, la supériorité numérique et technologique d’une nation profite à son adversaire. Attaques suicide, véhicules piégés, bombes, ces nouveaux modes d’action utilisés notamment par certains groupes terroristes (Haram au Sahel, Al-Qaïda, l’État islamique) sont dévastateurs d’autant plus qu’ils s’inscrivent dans une dimension transnationale. Dans le cas de l’Irak par exemple, un conflit en premier lieu dissymétrique (avec un rapport de force déséquilibré), lors de la guerre du Golfe (1991), qui, en 2003, s’est transformé en un bourbier asymétrique dans lequel Washington a fini par s’enliser.
Guerre commerciale : nouveau terrain de conflits ?
Si la mondialisation a pu redéfinir la nature de la guerre, c’est, d’évidence, sur le plan économique, facteur de nouveaux contentieux. Les États-Unis se sont progressivement dotés d’un arsenal législatif pour contourner les règles de l’OMC afin de faciliter l’imposition de taxes sur les produits chinois. Guerre de normes où le vainqueur est celui qui imposera le plus rapidement son modèle normatif. Dans ce combat, l’extraterritorialité du droit américain joue en la faveur de Washington qui en fait une arme géopolitique. Les exemples ne manquent pas : le Cloud Act, les sanctions contre l’Iran ou la Syrie qui s’est vue imposer les “lois César” en juin 2020.
Conclusion
Selon Mary Kaldor dans son ouvrage New and Old wars, les guerres d’aujourd’hui répondent à des logiques identitaires, héritées du passé, tandis que les anciennes se nourrissaient d’« idées » au service de l’avenir. Les anciennes plus « autarciques et centralisées » alors que les nouvelles « mondiales, dispersées, transnationales ». Les guerres d’aujourd’hui bénéficient à cet égard rarement d’un réel soutien populaire. En témoigne le « syndrome du Vietnam » qui oriente la géopolitique américaine actuelle (retrait partiel des troupes au Moyen-Orient).
À en voir la stratégie chinoise, où l’art suprême de la guerre consiste selon Sun Tzu à « soumettre son ennemi sans combat », la compétition économique mondialisée pourrait déterminer le futur dessin des conflits du XXIe siècle. Particulièrement à l’heure où l’argent reste indubitablement le nerf de la guerre.