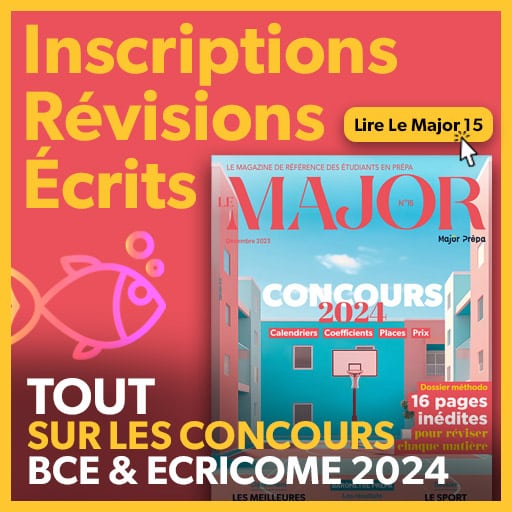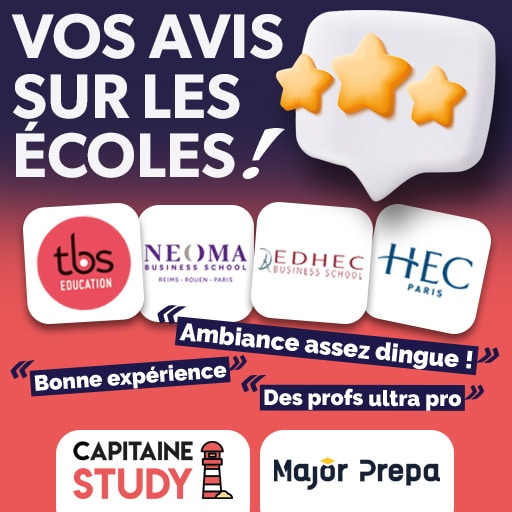Aujourd’hui, les ensembles régionaux latino-américains sont multiples et concernent à la fois les domaines politique, économique, mais aussi de la défense et des infrastructures. Pourtant, alors que la mondialisation a poussé au regroupement des états au sein de marchés toujours plus ouverts, les ensembles régionaux de l’Amérique du Sud semblent à l’arrêt, marqués par des difficultés internes aux états membres mais aussi par des tensions interétatiques. Comment se sont construits ces projets d’intégration régionale ? Et comment expliquer la situation actuelle ?
La volonté de créer des ensembles régionaux en Amérique Latine débute dès les années 1960. La plupart des pays d’Amérique Latine sont alors entrés dans une stratégie de développement autocentré, dite d’industrialisation de substitution aux seules importations. Les états latino-américains, portés par cette volonté de développement économique national, signent le traité de Montevideo en 1960, donnant naissance à l’ALALC (Association Latino-Américaine de Libre Commerce). Ce projet ambitieux, ayant pour but de créer une zone de libre-échange, échoue du fait de désaccords importants entre pays membres. D’autres ensembles voient également le jour par la suite, dans cette même logique de développement comme par exemple, la fondation du CARICOM (Caribbean Community) en 1973, qui ouvre la voie à une intégration régionale des pays caribéens.
L’avènement de la mondialisation et du néolibéralisme, couplé à l’échec des stratégies de développement autocentré forcent les états latino-américains dans les années 1990 à s’ouvrir aux investissements extérieurs, afin d’éponger leurs dettes. Les politiques néolibérales sont alors en vigueur en Amérique latine, entraînant des privatisations d’entreprises publiques, ainsi qu’une « reprimarisation » de leur économie, les investissements étrangers se tournant principalement vers les matières premières. Dès lors, s’inspirant de l’Union Européenne et de son marché commun, les états Sud-Américains fondent le marché commun Sud-américain (MERCOSUR) lors du traité d’Asuncion en 1991, qui regroupe l’Argentine, le Brésil, l’Uruguay, le Paraguay, la Bolivie et le Venezuela (ce dernier est suspendu en 2017). Les Etats d’Amérique centrale fondent également en 1991 le SICA (Système d’Intégration Centraméricain), qui se veut être une zone de libre-échange. On peut alors dire que l’Amérique latine cherche à s’insérer dans la mondialisation, à travers des zones de libre-échange.
Un tournant s’opère toutefois à la fin des années 1990. En effet, l’avènement d’un courant progressiste qui traverse l’Amérique du Sud provoque un rejet de la mondialisation et du néolibéralisme. A ce rejet du néolibéralisme, incarné par les dirigeants progressistes comme Hugo Chavez au Vénézuela, Evo Morales en Bolivie, Lula au Brésil, ou le couple Kirchner en Argentine, s’oppose un « droit au développement » exigé lors du Consensus de Buenos Aires en 2003, par l’Argentine et le Brésil. Une transformation importante s’opère alors : les ensembles régionaux doivent créer une « unité de destin », c’est-à-dire, une intégration non seulement économique, mais aussi politique. De nouveaux projets se forment, comme l’IIRSA en 2000 (Initiatives pour l’Intégration de l’Infrastructure Régionale Sud-Américaine) qui vise à relier les pays sud -américains entre eux via la construction ou la rénovation d’infrastructures, avec comme exemple la réhabilitation de la route entre Caracas (Venezuela) et Manaus (Brésil). L’UNASUR fondée en 2004 (Union des Nations Sud-Américaines) qui regroupe tous les pays de l’Amérique du Sud, pousse l’intégration des pays membres non seulement en matière de politique, mais aussi en matière de défense (l’Unasur est dotée d’un conseil de défense) ou d’énergie (l’anneau énergétique est un des projets de l’UNASUR, dont le but serait de raccorder les différents pipelines des pays sud-américains). Enfin, l’intégration politique peut aussi prendre des formes très virulentes dirigées contre l’influence des Etats-Unis et la mondialisation : c’est l’ALBA (Alliance Bolivarienne pour les Amériques) en 2004, regroupant notamment Cuba, et le Venezuela.
Trois logiques se sont donc suivies lors de la construction des grands ensembles régionaux : une logique de développement national tout d’abord, puis une logique d’insertion dans la mondialisation et enfin une logique continentale d’unité et d’intégration.
Qu’en est-il de la situation actuelle de ces grands ensembles ?
Les ensembles latino-américains semblent aujourd’hui à l’arrêt et cela est dû à plusieurs facteurs. Tout d’abord, leur trop grand nombre les rend inefficaces et peu lisibles. Ensuite, l’instabilité au sein même des états sud-américains freinent leur développement : la crise politique sur fond de corruption (affaire Petrobras au Brésil touché également par une vague de violence importante dans l’Etat de Rio) ; la crise économique et politique au Venezuela, où Nicolas Maduro a renforcé considérablement son pouvoir en créant une assemblée constituante à sa solde. Ces instabilités internes affectent les politiques de ces deux pays, focalisées sur l’apaisement de la situation nationale, et qui se trouvent fragilisées lors des négociations au sein des ensembles régionaux. Sans hommes forts soutenus par une majorité solide, les ensembles régionaux peinent à décider d’un cap commun. Or aujourd’hui, le couple Argentine-Brésil, moteur traditionnel de l’intégration régionale du continent, est dans l’impasse : Michel Témer est dans une situation très précaire au Brésil, et des manifestations éclatent régulièrement en Argentine contre les politiques d’austérité mises en place par le président Mauricio Macri.
A ces situations internes instables, s’ajoutent les tensions historiques entre certains pays, qui freinent leur coopération dans les grands ensembles régionaux. On peut citer par exemple les tensions récurrentes entre la Colombie, et le Venezuela ; mais également les tensions entre le Chili et la Bolivie, ce dernier pays demandant un accès à la mer qu’il possédait historiquement (mais qu’il a perdu lors de la guerre du Pacifique (1879-1883)). Ces tensions internes sont exploitées par les grandes puissances internationales, qui cherchent à s’implanter sur le continent Sud-Américain : la Chine, les Etats-Unis, mais également la Russie, qui a par exemple effacé plus de 1 milliard de dollars de la dette vénézuélienne en 2017.
Le défi d’un développement à la fois économique de l’Amérique Latine, mais également politique (c’est-à-dire une indépendance vis-à-vis des grandes puissances américaines ou chinoises) reste entier. Si les Etats Sud-Américains ont rejeté la ZLEA (Zone de Libre-Echange Américaine) voulue par Washington, les investissements chinois, eux, ont augmenté -et ont été multipliés par 21 en 10 ans atteignant près de 260 Milliards de dollars en 2012-. On assiste aussi à un rééquilibrage de l’influence américaine en Amérique du Sud, rééquilibrage accéléré par le désintérêt porté par Donald Trump pour cette région. Ce rééquilibrage se fait au profit des nouvelles grandes puissances, comme la Chine.