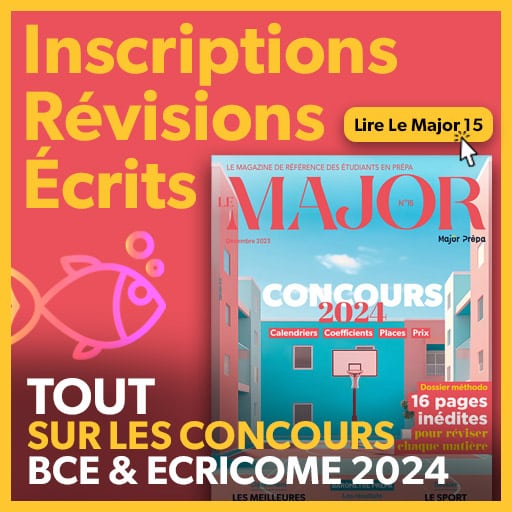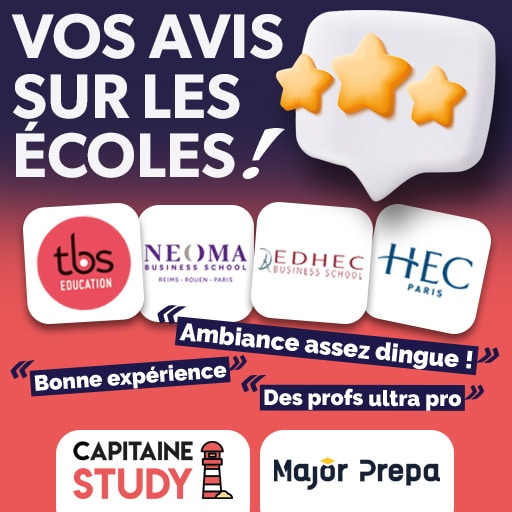L’utilisation de références récentes est particulièrement valorisée par les correcteurs en dissertation d’ESH ; elle prouve un investissement de la part de l’élève (ou de son professeur !), qui s’efforce de suivre l’actualité économique. La mention d’articles de recherche – terme qu’on emploiera pour parler indistinctement d’articles et de working papers – et non pas d’ouvrages, a elle, de multiples avantages. Il est évidemment en premier lieu bien plus facile de lire un article de moins de dix pages (ou la synthèse qui l’accompagne souvent) qu’un livre entier.
Citer un spécialiste du domaine est ensuite assez apprécié et permet souvent d’apporter des éléments (chiffres, analyses, etc.) plus précis et précieux. C’est pour ces raisons que cinq articles récents te sont proposés ici avec un bref compte rendu de leur contenu, te permettant ainsi de les replacer dans tes dissertations d’ESH avec aisance.
1. « Quand la Chine s’endormira », Patrick Artus (mars 2021)
Il s’agit là d’une chronique et non d’un article de recherche au sens strict, mais son contenu, bien que moins « légitime », reste tout de même particulièrement intéressant. Patrick Artus propose en effet ici des prédictions autour de la croissance économique chinoise à venir. Selon lui, plusieurs facteurs handicaperont la croissance jusqu’ici galopante de la Chine. En effet, le vieillissement démographique en Chine est tel qu’il pourrait pénaliser la population active du pays et ainsi réduire sa capacité à créer de la richesse. Face à cela, la Chine devrait, selon Artus, délocaliser ses activités en Afrique, où l’âge médian est de 20 ans environ.
Le pays connaît par ailleurs une forte hausse de l’investissement dans le bâtiment, avec par exemple une hausse de 10 % des dépenses dans le secteur avec le plan de relance lié à la pandémie ; or, le bâtiment est par nature moins rentable que les technologies et un délaissement (à nuancer, puisque 2,8 % du PIB chinois en 2018 était consacré à la R&D) pérenne des technologies au profit du bâtiment pourrait porter préjudice à la croissance chinoise. Enfin, l’accent porté sur les entreprises d’État (state-owned properties) et l’emprise publique sur les entreprises privées (à l’image d’Ant Group) nuisent inévitablement à la croissance : si les entreprises publiques ont un taux de rendement de 4 %, celui des firmes privées atteint 10 %. Il s’agirait donc pour Artus d’accentuer éventuellement la pression politique pour s’orienter vers le développement d’un modèle tourné vers le privé.
2. « Sortir du cercle vicieux du décrochage industriel », Thomas Grjebine (mars 2021)
L’industrie manufacturière française représentait 11 % du PIB national en 2019 contre 17,5 % en 1995 et contre une moyenne de 16 % dans l’Union européenne en 2019. Si la désindustrialisation ne semblait pas initialement problématique aux dirigeants, car il était commun de penser que l’industrie serait remplacée par les services, c’est aujourd’hui une réelle préoccupation. D’abord, parce que l’industrie concentrait 70 % de la R&D en 2018 et perdre de tels efforts d’innovation peut s’avérer dramatique. Contrairement à la France, l’Allemagne a su préserver bien mieux sa base industrielle – notamment grâce à son modèle néomercantiliste instauré depuis les années 2000, qui en comprimant la demande interne par une forte imposition permet une baisse des importations et une hausse des exportations, soit un excédent commercial propice à l’industrie locale –, avec une industrie représentant 22 % du PIB (2019), ou encore la Corée du Sud avec une part de 29 % (2019).
Pour pallier la désindustrialisation en France, Grjebine note d’abord que des relocalisations systématiques seraient inutiles car les secteurs véritablement « stratégiques » sont peu nombreux. Il s’agirait plutôt de protéger les restes de l’industrie française et d’essayer de développer de nouvelles filières par des politiques industrielles innovantes, et notamment dans le cadre de la transition écologique.
3. « “Buy American” and similar domestic purchase policies impose high costs on taxpayers », Gary Hufbaeur et Euijin Jung (août 2020)
Le Buy American Act, loi américaine de 1933 destinée à favoriser l’industrie américaine en approvisionnant les administrations publiques en produits locaux, impose un coût exorbitant pour le contribuable américain en haussant considérablement le prix des commandes publiques. Le montant de celles-ci augmentait en effet de 5,6 % en 2017 et coûtait 94 milliards de dollars aux Américains, de même, chaque emploi préservé sur le territoire par des mesures protectionnistes représente un coût de 250 000 $ ; sommes qui auraient pu être dépensées dans la formation pour permettre les réorientations professionnelles.
4. « Souveraineté économique : entre ambitions et réalités », Emmanuel Combe et Sarah Guillou (janvier 2021)
Pour les auteurs, la souveraineté économique désigne la capacité d’un pays à se rendre indispensable dans la chaîne de valeur (sur la courbe du sourire de Stan Shih) et à s’assurer de la disponibilité de certaines productions jugées essentielles. Si cela justifie certaines politiques de relocalisation de productions stratégiques, il est souligné qu’il est impossible – et non souhaitable – de tout produire soi-même de manière autarcique puisque cela relève du mythe du potager. Il s’agit de rester modéré dans les relocalisations et de ne pas considérer que toutes les productions sont stratégiques – « Quand tout est stratégique, plus rien n’est stratégique », pour Combe –, car s’approvisionner à l’étranger constitue le privilège de l’acheteur qui, en important, choisit scrupuleusement sa dépendance.
5. « Competing with Robots: Firm-Level Evidence from France », Daron Acemoglu, Claire Lelarge et Pascual Restrepo (mai 2020)
Les auteurs, ayant déjà étudié les effets de la mécanisation sur la main-d’œuvre et sur la production, testent leurs hypothèses sur 55 390 firmes françaises, dont 598 ont implémenté des machines dans leur processus productif. Ces 598 entreprises, soit un peu plus de 1 % de l’échantillon total, représentent néanmoins 20 % de l’emploi manufacturier de l’ensemble des firmes étudiées. Les entreprises françaises robotisées connaissent initialement une baisse de la part du travail dans la valeur ajoutée ; les machines remplacent les emplois humains.
Néanmoins, en rendant les firmes plus productives et donc aptes à conquérir de nouveaux marchés, les machines permettent par la suite une hausse des embauches. Les firmes robotisées connaissent une hausse de leur productivité telle qu’elles grandissent bien plus vite que leurs concurrentes non robotisées ; ces dernières, largement devancées et en difficulté, tendent, elles, à licencier leurs employés. La corrélation entre adoption de robots et emploi est donc finalement positive.