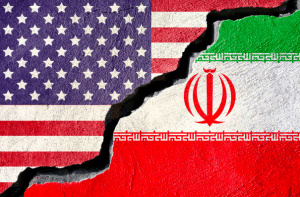Quel rôle pour le Maroc dans la politique migratoire Européenne ?
Le 11 août dernier, Pedro Sanchez (président du gouvernement d’Espagne) et Angela Merkel (chancelière allemande) ont affiché leur bonne entente pour faire à la crise migratoire. Les deux dirigeants souhaitent que le Maroc bénéficie d’un plus grand soutien européen comme pays d’origine et de transit de migrants. L’Espagne est devenue cette année la première porte d’entrée de migrants clandestins par la mer (à raison de 23 000 entrées depuis début 2018), devant l’Italie et la Grèce. En effet, seuls quatorze kilomètres séparent les côtes de l’Espagne, et donc de l’Europe, de celles de l’Afrique du Nord.
Sanchez et Merkel ont donc convenu d’« intensifier le dialogue et la coopération avec les pays d’origine et de transit » des migrants et « principalement avec le Maroc ». Ils souhaitent que la Commission européenne débloque des ressources économiques pour permettre au Maroc d’être plus efficace dans le contrôle de ses frontières, au départ des embarcations vers les côtes espagnoles. Cependant, l’association marocaine des droits humains (AMDH) dénonce déjà des déplacements illégaux et violents de migrants car sans mandats judiciaires et désigne comme responsables le Maroc, l’Espagne et l’Union Européenne (UE). On peut donc imaginer que la régulation de la migration va rester difficile.
Source image https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/w3uCxpsWyg22H7FyD61L5Q–~B/aD01MTU7dz04MDA7c209MTthcHBpZD15dGFjaHlvbg–/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2018-06-26T143850Z_1_LYNXMPEE5P1BE_RTROPTP_3_GERMANY-SPAIN-SANCHEZ-ARRIVAL.JPG
La situation s’envenime entre le Canada et l’Arabie Saoudite
La mésentente a débuté au début du mois d’août lorsque la ministre des affaires étrangères canadienne (Chrystia Freeland) a critiqué l’Arabie Saoudite concernant le respect ou plutôt le non-respect des droits de l’homme. Suite à ces critiques, l’Arabie Saoudite a réagi en renvoyant l’ambassadeur canadien. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont également été suspendus. Les étudiants saoudiens travaillant au Canada vont être rapatriés dans leur pays d’origine et les vols de la compagnie Saudia (la compagnie nationale) entre le Canada et l’Arabie Saoudite sont suspendus depuis le 13 août. Cet incident diplomatique révèle au grand jour la puissance qu’est devenue l’Arabie Saoudite sur la scène mondiale. En effet, aucun pays occidental, ni les États-Unis, ni la France, ni l’Union Européenne n’a exprimé son soutien envers le Canada pour éviter de se froisser avec l’Arabie Saoudite, pays avec lequel ils partagent des accords très importants, notamment sur le plan militaire. Cette crise diplomatique montre aussi les limites de l’ouverture sociale que veut mettre en place le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salmane. Même s’il a par exemple autorisé les femmes à conduire, il a également été à l’origine de plus d’une dizaine d’arrestations de militantes des droits des femmes depuis le mois de mai.
Source image : http://scd.rfi.fr/sites/filesrfi/imagecache/rfi_16x9_1024_578/sites/images.rfi.fr/files/aef_image/2018-05-31t184908z_1151247187_rc19077b7670_rtrmadp_3_usa-trade-canada_0.jpg
Les États-Unis confirment le retour à une politique anti-iranienne
Washington impose de nouvelles sanctions économiques à l’Iran depuis le 7 août dernier, ce qui n’est pas sans rappeler la politique des années 2000, menée par George W Bush. Cette première vague de sanctions américaines comprend des blocages sur les transactions financières et les importations de matières premières, ainsi que des mesures pénalisantes sur les achats dans le secteur automobile et l’aviation commerciale. Elle sera suivie, en novembre, de mesures affectant le secteur pétrolier et gazier ainsi que la Banque centrale. Ces sanctions devraient peser lourdement sur une économie iranienne à la peine, qui souffre d’un taux de chômage élevé et d’une nette inflation. Le rial iranien a plongé, perdant près des deux tiers de sa valeur en six mois. Des manifestations ont déjà éclaté à l’annonce du retour aux sanctions. Ces sanctions sont toutefois largement critiquées aujourd’hui en Europe et en Asie. Continuer ou non à avoir des relations économiques avec Téhéran devient un choix diplomatique, puisque les États-Unis exercent une pression sur les autres nations afin d’être suivis dans leur démarche. Pour rappel, BNP Paribas a été condamné en 2014 à payer une amende de près de 9 milliards de dollars aux États-Unis pour… avoir effectué des transactions en dollars avec certains pays sous embargo américain, aux rangs desquels l’Iran.
Donald Trump depuis son arrivée au pouvoir affiche une position très hostile envers l’Iran. Il choisit cette stratégie agressive car il souhaite conforter ses positions et celles de ses alliés au Moyen-Orient : Israël et l’Arabie Saoudite, aujourd’hui mis en difficulté par Téhéran. En sortant de l’accord sur le nucléaire iranien de 2015 qu’il jugeait défavorable pour son pays en mai dernier, le président américain a décidé de remettre la pression sur l’Iran. Washington affirme toutefois rester ouvert à un nouvel accord, qui engloberait la question nucléaire mais également celle des activités iraniennes en Syrie (soutien à Bachar el-Assad), au Yémen (soutien aux rebelles Houthis), en Palestine (soutien au Hamas) et au Liban (soutien au Hezbollah). Les autorités iraniennes ont déjà décliné cette invitation, affirmant que le seul accord possible est celui du Joint Comprehensive Plan of Action (JCPoA) de 2015.
Le discours des années Bush se retrouve également sur la volonté d’un « regime change » en Iran. Ce vocabulaire séduit évidemment une partie de l’opinion publique occidentale, hostile au régime en place. Cependant, Téhéran pourra compter sur la Chine, l’Inde, la Russie et peut-être même la Corée du Sud, pour continuer à commercer. La Chine a en effet déjà profité du retrait européen pour récupérer plusieurs contrats. Ainsi, la CNPC (China National Petroleum Corporation) prend la place de Total dans le domaine de l’énergie. La Russie, comme la Chine, continuera de faire des affaires avec l’Iran, au moins pour des raisons politiques, par anti-américanisme principalement. Le Kremlin a même déjà invité l’Iran à rejoindre l’union douanière de l’Union eurasiatique.
L’Union européenne et ses membres sont donc aujourd’hui confrontés à un dilemme : suivre la politique américaine et abandonner une partie de leur souveraineté ou continuer à respecter l’accord, au risque d’être qualifié, outre-Atlantique, comme soutien du régime iranien. La Commission européenne a donné une indication sur la marche qu’elle souhaitait suivre en mai dernier. Elle a en effet activé une loi autorisant les entreprises européennes à ne pas se conformer aux sanctions américaines contre l’Iran. La banque centrale européenne a également mis en place des outils financiers pour faciliter les investissements des entreprises européennes en Iran.
Le détroit d’Ormuz, une arme à double tranchant
Comme c’est le cas à chaque grande crise diplomatique, le gouvernement iranien brandit la menace d’une fermeture du détroit d’Ormuz. Cependant, cette manœuvre, si elle avait lieu, bloquerait une large partie des exportations pétrolières saoudiennes, koweïtiennes et émiraties. De plus, la fermeture du détroit pourrait aboutir à une escalade des tensions militaires dans la région défavorable à Téhéran. En effet, si cette situation de blocage arrivait, une riposte de la marine américaine serait possible et mettrait certainement à genou les forces navales iraniennes. Même en l’absence d’une réponse occidentale, le blocage d’Ormuz pénaliserait en premier lieu l’économie iranienne déjà en difficulté, puisque Téhéran verrait ses exportations pétrolières diminuer drastiquement. Enfin, la montée des cours du pétrole qui s’en suivrait serait de nature à froisser plusieurs partenaires de l’Iran et en premier lieu la Chine.
Source image : https://media.istockphoto.com/photos/concept-american-and-iran-flag-on-cracked-background-picture
L’Irak, première victime collatérale des sanctions contre l’Iran
Prise en tenaille entre ses deux alliés américain et iranien, l’Irak est la première victime des sanctions de Washington contre son grand voisin, sanctions qui pourraient la priver de biens vitaux et de milliers d’emplois. Le pays est déjà englué depuis un mois dans un mouvement de contestation sociale dénonçant le marasme économique, les pénuries chroniques d’électricité, le chômage grandissant et l’incurie de la classe politique, au moment où la sécheresse a réduit drastiquement les recettes agricoles.
Il s’apprête maintenant à encaisser un coup plus dur encore pour son économie rendue déjà exsangue par l’effort de guerre contre les djihadistes du groupe État islamique (EI) et la corruption : la perte de son deuxième importateur, l’Iran. En 2017, l’Irak a déboursé près de 6,6 milliards de dollars (5,7 milliards d’euros) pour importer d’Iran des biens de consommation aussi variés que des tomates, des couvertures ou des voitures.
Pour les clients, les produits iraniens ont un avantage crucial : ce sont les moins chers du marché. Pour les produits finis, les importations, en dollars, ont déjà cessé, comme s’y est engagé le Premier ministre Haider al-Abadi, qui a toutefois souligné le faire à contrecœur. Il a déclaré : « Pour nous conformer aux sanctions américaines, nous avons cessé d’importer des voitures iraniennes », les plus nombreuses. Environ 5000 emplois, qui dépendent de ces échanges, sont suspendus.
Manifestations en Israël contre la loi sur « l’État-nation du peuple juif »
Des milliers d’Arabes israéliens ont manifesté début août à Tel-Aviv pour dénoncer une loi controversée définissant Israël comme « l’État-nation du peuple juif ». Le rassemblement a été organisé à l’initiative d’organisations représentant la minorité arabe israélienne, qui constitue 17,5 % de la population, alors que, la semaine dernière, une énorme manifestation avait déjà réuni des Druzes, une autre minorité, opposée aussi à cette loi.
Pour ces minorités druze et arabe, la loi fait d’eux des citoyens de seconde zone. Des juifs israéliens se sont joints aux manifestants pour défendre le principe d’égalité, tout en traitant le Premier ministre Benjamin Netanyahu de « fasciste ».
La loi votée par la Knesset (le parlement de l’état d’Israël) le 19 juillet confère aux juifs le droit « unique » à l’autodétermination en Israël et proclame que l’hébreu comme seule langue officielle d’Israël. L’arabe n’a qu’un statut « spécial » qui n’a pas encore été défini. Aucun article ne mentionne l’égalité entre les citoyens ou le caractère démocratique du pays, faisant craindre que le caractère juif d’Israël ne prime les autres principes. Ce texte inquiète d’autant plus les minorités que le document fait partie des lois fondamentales qui font office de Constitution, inexistante en Israël.
Malgré plusieurs appels déposés contre la loi devant la Cour suprême. Benjamin Netanyahu a affirmé qu’il n’avait pas l’intention de modifier la loi en expliquant que, sans ce texte, « il sera impossible de garantir pendant des générations l’avenir d’Israël comme État national juif ».
En 1992, une loi fondamentale consacre le tandem « juif et démocratique ».Ce n’est pas le fait qu’Israël soit déclaré « État-nation du peuple juif » qui constitue en soi un tournant majeur, puisque c’était déjà le désir des pères fondateurs, mais plutôt la disparition du terme « démocratique », niant ainsi les droits des minorités non-juives.
Source image :
https://o.aolcdn.com/images/dims3/GLOB/crop/5596×2803+0+476/resize/630×315!/format/jpg/quality/85/http%3A%2F%2Fo.aolcdn.com%2Fhss%2Fstorage%2Fmidas%2F4386f4bbad2a194913863c0ba227e7d9%2F206116453%2FRTX4VC1H.jpeg
L’inquiétante escalade de la violence entre Gaza et Israël
Gaza et Israël seraient « dangereusement proches » d’un nouveau conflit après les récents affrontements d’après l’Union européenne qui appelle à ne pas mettre davantage de vies de civils en danger. Le jeudi 9 août, l’aviation israélienne bombardait le centre culturel Said Al-Meshal, dans le centre de Gaza-Ville. Ce bâtiment de cinq étages abritait entre autres un théâtre, une bibliothèque ainsi que le bureau de la communauté égyptienne de Gaza. La frappe israélienne a clôturé 24 heures d’intense escalade. Le 8 août, les factions palestiniennes avaient tiré 200 roquettes et obus depuis Gaza vers le sud d’Israël. L’armée israélienne a frappé en retour 150 cibles militaires du Hamas dans l’enclave. Les raids aériens ont fait dix-huit blessés palestiniens, et trois morts. Du côté d’Israël, on compte une vingtaine de blessés. L’armée israélienne, pour se justifier, a déclaré avoir localisé dans le centre Said Al-Meshal les bureaux des forces de sécurité intérieure du Hamas, le mouvement qui contrôle la bande de Gaza depuis 2007.
Chaque nouvelle poussée attaque fragilise l’accord d’un cessez-le-feu de longue durée, négocié depuis mars par l’intermédiaire de l’Égypte et des Nations unies. Comme à la fin de la guerre de 2014, lorsque des bâtiments affiliés au Hamas étaient ciblés en plein Gaza-Ville, la frappe du 9 août a sonné comme un avertissement : la promesse d’une guerre destructrice à Gaza, en cas de surenchère de la part du Hamas. Les factions palestiniennes n’ont d’ailleurs pas répliqué, approuvant le soir même l’accord de cessez-le-feu soumis par l’Égypte.
Source image :https://img.lemde.fr/2018/08/09/0/0/3326/2182/534/0/60/0/b5649a6_5129115-01-06.jpg
La Turquie face à la crise
Comment expliquer cette crise turque ?
Pour le président Erdogan, «un complot», est à l’origine de l’effondrement de la devise nationale, la livre turque. À l’origine de la crise monétaire, qui s’est précipitée le 10 août dernier :la crise diplomatique entre Washington et Ankara autour du sort d’Andrew Brunson. Ce citoyen américain a été arrêté en octobre 2016, accusé d’être impliqué dans la tentative avortée de coup d’État de juillet 2016. Après près de deux ans de détention, finalement placé en résidence surveillée, Brunson est jugé pour « terrorisme » et «espionnage». Alors qu’ils réclamaient sa libération depuis des mois, les États-Unis ont annoncé, le 3 août dernier, des sanctions contre le ministre turc de la Justice. Le 10 août, Donald Trump est allé encore plus loin en promettant un doublement des taxes douanières sur l’acier et l’aluminium turcs exportés aux États-Unis. Cette escalade a fait chuter la livre turque jusqu’à 19 % dans la seule journée du 10 août.
Quels sont les ravages causés par la chute de la livre en Turquie ?
La dépréciation de la devise de plus de 22 % en une semaine a, pour les Turcs, l’effet exactement l’inverse du bonus bénéficiant aux touristes étrangers. L’inflation dérape depuis des mois et a atteint près de 16 % en rythme annuel en juillet. Les ménages turcs importent des biens de consommation durable (automobile, électronique) mais aussi des vêtements. Les entreprises, qui achètent beaucoup de biens intermédiaires à l’étranger, vont voir leurs coûts de production augmente. Si en théorie une dépréciation de la devise doit booster les exportations, les crises des pays émergents montrent que les exportations réagissent finalement peu. En effet, en période de taux de change très volatils il est très difficile de fixer les prix à l’export.
Pour tenter de contrer la chute de la livre, la banque centrale a commencé à relever ses taux d’intérêt. Avec des crédits à la consommation à 25 %, l’accès au financement va devenir encore plus difficile.
Ainsi, la consommation va se trouver fortement freinée, alors qu’elle contribue à hauteur des deux tiers de la croissance turque.
Membre du G20, le club des grandes puissances, la Turquie affichait l’an dernier 7 % de croissance. Les dernières prévisions, qui n’intègrent pas la crise des derniers jours, tablaient sur un ralentissement à 4 %. Une crise semblait prévisible. La Turquie présente en effet l’un des déficits courants les plus élevés parmi les pays émergents : pour financer une forte demande intérieure, elle n’épargne pas assez et s’endette trop. On peut critiquer à cet égard la politique monétaire en vigueur dans le pays : le président Erdogan a tout fait pour ne pas relever les taux d’intérêt comme il aurait fallu depuis des mois afin de défendre la monnaie et limiter le recours au crédit. En janvier, le taux directeur réel, c’est-à-dire déduit de l’inflation, était négatif de 5. Si le contexte politique à l’origine de la crise de confiance ne change pas, la dépréciation de la livre risque surement de se poursuivre.
Existe-t-il un risque de contagion sur les marchés mondiaux ?
La crise soulève quelques inquiétudes à l’étranger. : la livre turque a entraîné les Bourses mondiales dans le rouge. Mais avec mesure : – 0,04 % à Paris, – 0,53 % à Francfort ou – 0,75 % à Madrid dont les banques sont les plus exposées au risque turc parmi les établissements européens.
Les investisseurs vendent leurs titres jugés risqués. En Europe, cela se traduit par une tension sur les taux d’emprunt des pays du Sud, plus fragiles. Pour l’instant, les pays émergents sont en première ligne. Dans le sillage de la livre turque, le rouble russe, le peso argentin, le rand sud-africain ou encore le réal brésilien sont secoués sur les marchés des changes. Tous ces pays sont victimes, depuis le printemps, de la hausse des taux d’intérêt américains qui attirent les capitaux massivement vers les États-Unis. Alors que l’économie turque ne pèse que 1 % du PIB mondial, l’impact de la crise frappant le pays d’Erdogan devrait être limité. Mais il existe toutefois un risque de « contagion financière» comme pour la crise asiatique de 1997-1998 ou la fuite de capitaux des pays émergents lorsque la FED avait annoncé, au printemps 2013, une future hausse de ses taux. Si la panique devait toucher d’autres économies émergentes, alors nous pourrions être confrontés à une crise plus systémique.