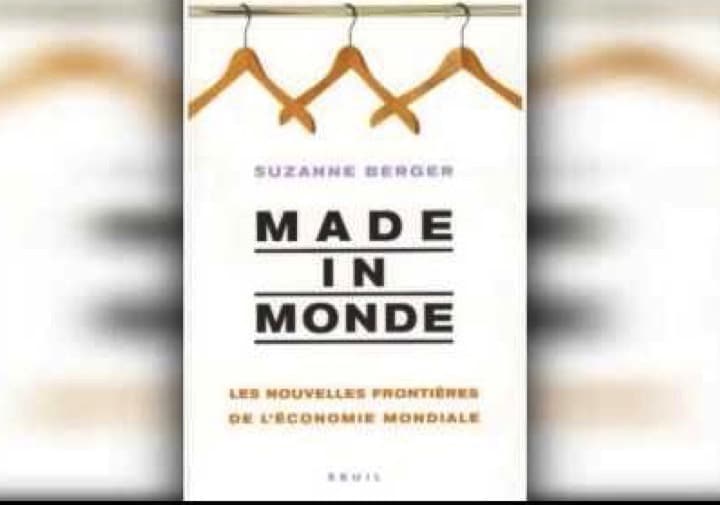Il est impératif d’agrémenter tes dissertations avec des références. L’article qui suit aura pour objectif de te familiariser avec une œuvre essentielle, certainement l’un des « best-of » du préparationnaire averti : le livre de Suzanne Berger, Made in Monde : Les nouvelles frontières de l’économie mondiale. Lorsque tu achètes un smartphone, un ordinateur ou une poupée, il est relativement difficile de savoir réellement l’origine du produit. Pourquoi ? Tout simplement parce que la production est désormais mondiale, avec des pièces détachées provenant de plusieurs pays différents. Suzanne Berger prend l’exemple plutôt pertinent des poupées du futur : elles seront dessinées aux États-Unis ; leurs cheveux confectionnés au Japon ; leurs vêtements conçus en France ; leur corps moulé à Taïwan ; et le tout assemblé en Chine.
Ce changement de paradigme effraie, puisqu’il est associé dans l’imaginaire collectif à des concepts comme la délocalisation, le chômage, le dumping, l’uniformisation du monde, les salaires à bas coûts, l’exploitation de l’homme par l’homme (esclavage moderne)… Et si on faisait fausse route ? C’est exactement ce que Suzanne Berger tente de démontrer dans cet ouvrage indispensable pour comprendre les enjeux modernes de la mondialisation en s’appuyant sur une analyse approfondie des pratiques et autres stratégies de cinq cents entreprises à travers le monde.
Biographie
En deux mots, Suzanne Berger est une historienne et politologue américaine, reconnue par tous comme une spécialiste de la mondialisation. Elle a publié quelques livres comme Notre Première Mondialisation : Leçons d’un échec oublié (2003) et Made in monde. La mondialisation est ainsi son objet d’étude essentiel. Selon elle, cette dernière n’aurait été possible sans l’ouverture des entreprises à l’économie mondiale. Ceci ne signifie pas pour autant que les entreprises sont aujourd’hui totalement “déterritorialisées” ou encore que les États perdent en légitimité. Bien au contraire, plus que jamais, l’entreprise s’ancre dans un territoire et le rôle de l’Etat – à défaut de s’amoindrir – est devenu essentiel afin de conserver l’héritage d’entreprises locales.
Résumé
Le but de cet ouvrage est de s’attaquer aux idées reçues. Non, la mondialisation ne détruit pas les emplois dans les pays dits du Nord (si l’on se fie à la classification de Brandt). Non, le protectionnisme n’est pas une solution aux problèmes économiques actuels (n’en déplaise aux pourfendeurs de la mondialisation comme D. Trump). Non, la sidérurgie n’est pas condamnée, l’économie mute, mais ça n’implique pas pour autant la disparition de tous les secteurs, puisque l’on aura encore besoin de fer et d’acier à l’avenir. Non, la délocalisation n’est pas le meilleur moyen pour augmenter les profits, différentes stratégies sont possibles. Pour illustrer cela, l’auteur s’appuie sur les stratégies de 500 entreprises différentes et souligne ainsi qu’il n’y a pas qu’une seule façon d’appréhender les enjeux posés par la mondialisation.
Une étude de cas éloquente : Luxottica
À quoi bon délocaliser sous prétexte que la main-d’œuvre serait moins chère ? Parfois, il est préférable de conserver une implantation locale. En effet, délocaliser implique ipso facto des coûts auxiliaires comme l’affirme Suzanne Berger : « Même dans des industries slow-tech comme le textile/prêt-à-porter, le coût du travail n’est qu’un facteur parmi d’autres du coût total lié à une délocalisation : transport, matériaux, capital, mais aussi incertitude quant à l’infrastructure sur place, corruption des autorités publiques, arbitraire politique, etc. sont autant de questions à se poser avant de délocaliser. Pour les entreprises que nous avons étudiées, tous ces facteurs jouent un rôle beaucoup plus important que le seul coût du travail. » En effet, une main-d’œuvre peu qualifiée et peu chère n’est pas pour autant plus rentable qu’une main-d’œuvre qualifiée et coûteuse. Et pour cause, la main-d’œuvre qualifiée a un taux de productivité bien supérieur. Ainsi, parfois, délocaliser se révèle être peu rentable : la nouvelle main-d’œuvre est lente, moins fiable et la qualité du produit peut également laisser à désirer.
Pour illustrer son argument, S. Berger prend l’exemple de la marque italienne de lunettes Luxottica. En prenant en compte tous les facteurs cités ci-dessus, elle constate que le coût final de production d’une monture est de 2,63$ en Chine, 2,49$ en Irlande et 1,2$ en Italie, alors même que la main-d’œuvre y est la plus chère. En fait, l’économie réalisée en Chine ou en Irlande sur la main-d’œuvre est annulée par une qualité défectueuse des verres et de nombreux dysfonctionnements au sein des usines chinoises ou irlandaises.
(J’adorais utiliser cet exemple plutôt éloquent dans mes dissertations sur la mondialisation afin d’illustrer à quel point la délocalisation n’est pas la panacée universelle pour rester compétitif sur l’échiquier mondial. Au contraire, produire localement s’avère très souvent être une bonne façon d’appréhender un marché devenu de plus en plus complexe.)
S. Berger souligne d’ailleurs l’intérêt de choisir correctement ses sous-traitants. « Quand les fonctions aussi importantes que la fabrication sont sous-traitées, le sort de l’entreprise dépend d’autres intervenants au sein de la chaîne d’approvisionnement. » Le scandale qu’a subi Apple avec son sous-traitant Foxconn en est le meilleur exemple et tend à montrer que sous-traiter n’est pas toujours la meilleure solution.
La recherche du meilleur rapport coût-avantage…
Pour les entreprises, la mondialisation se résume souvent à la recherche du meilleur rapport coût-avantage. Ceci s’explique tout simplement par le fait que l’on assiste aujourd’hui à une guerre économique effrénée entre les différentes entreprises qui partagent le même objectif : maximiser les profits.
Dès lors, on assiste depuis l’avènement de ce processus qu’est la mondialisation à un changement profond de paradigme : la production est devenue internationale dans le sillage des délocalisations, entraînant par la même occasion des licenciements chez les vieux pays industriels et une embauche accrue dans les pays émergents ou en développement. L’organisation des systèmes productifs connaît in fine également une mutation importante, puisque selon les mots mêmes de S. Berger : « la production ressemble maintenant beaucoup plus à un jeu de Lego qu’à une maquette d’avion. »
En effet, l’ancien système se caractérisait par sa rigidité : les pièces ne s’ajustaient que de manière unique sur le produit (« Il n’y a qu’une façon d’assembler ces pièces et aucune ne peut être réutilisée dans une autre configuration pour construire un autre avion. »). Au contraire, le nouveau système développé avec les NTIC (nouvelles technologies de l’information et de la communication) et la DIPP (division internationale du processus de production) est basé sur la modularité : toutes les pièces nouvelles ou anciennes peuvent s’ajuster à tous les schémas possibles. Ce ne sont plus les produits qui sont standardisés mais leurs composants, qui peuvent être réutilisés dans une multitude de produits (comme les briques du Lego) contrairement aux composants des « maquettes d’avion ». En parallèle, les entreprises ont fragmenté leur production en cherchant les territoires les plus avantageux pour délocaliser et sous-traiter. C’est ainsi que la Chine est devenue « l’atelier puis l’usine du monde ».
Produire local ou à l’étranger, le dilemme de l’économie mondialisée…
Comme on l’a déjà vu précédemment, l’enjeu principal de ce livre est d’étudier les stratégies des entreprises pour réussir dans l’économie-monde. Se pose de facto la question de la délocalisation. On constate aujourd’hui qu’une exigence accrue des consommateurs est que l’entreprise soit locale et qu’elle produise localement. L’une des stratégies en vogue est celle développée par l’ex-PDG de Sony Akio Morita : « Think Global Act local ». Il est essentiel pour les entreprises de « fabriquer où elles vendent » (Ford, GM, Haier), quand bien même elles sous-traitent la production de certaines pièces détachées. D’ailleurs, de nombreuses entreprises sont prêtes à accepter des coûts plus élevés d’administration et de production pour réussir sur le marché visé en s’adaptant aux exigences du consommateur. C’est ce que S. Berger nomme « l’effet frontière » : ce qui se produit localement se vend mieux que ce qui est produit à l’étranger. La justification de cette tendance se trouve certainement dans la psyché collective : l’homme se définit par une forme de chauvinisme. C’est pourquoi elle affirme : « Ni l’Europe, ni les Etats-Unis n’ont à redouter un mouvement massif de délocalisations. » Outre cet argument, il y a de nombreux avantages à produire localement comme l’illustre l’exemple Luxottica (gain de temps dans la distribution, minimisation du coût de transport et des frais de sous-traitance…).
Conclusion
« La mondialisation n’est pas un choc exogène : elle est le résultat de millions de choix réalisés par les entreprises, concernant les activités qu’elles veulent garder sous leur toit, celles qui seront sous-traitées à d’autres et l’implantation de toutes ces activités. »
La mondialisation est le fruit de la fragmentation des systèmes de production et de l’ouverture des entreprises à de nouveaux marchés et à de nouveaux territoires de production. Cependant, chercher inlassablement à produire là où la main-d’œuvre est la moins chère ne s’avère pas être la stratégie gagnante selon S. Berger. Elle invite plutôt les entreprises à avoir une stratégie multiscalaire en combinant une réflexion locale et en cultivant un héritage, sans pour autant s’opposer à l’ouverture. Elle s’oppose ainsi aux pourfendeurs de la mondialisation qui louent le protectionnisme pour conserver les emplois, alors même que la vraie cause du chômage se trouve dans l’automatisation et non dans les délocalisations.
Made in Monde, voilà ce qu’on lira peut-être un jour sur nos étiquettes, en attendant, on devrait le lire dans de nombreuses copies d’HGGMC 😉