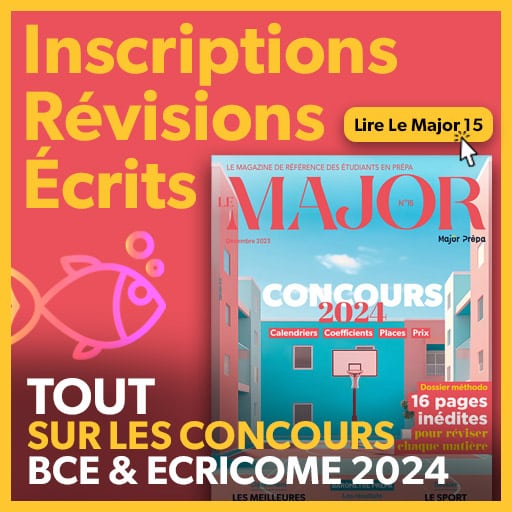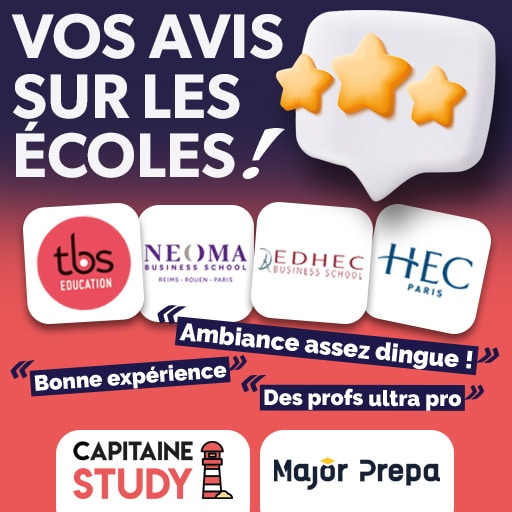« Qui tient la mer tient le monde. » (Pierre Royer, Géopolitique des mers et des océans). Si l’on se fie à cette citation, il semblerait que la mer joue un rôle très important dans notre mondialisation contemporaine : réservoir abondant de ressources, lieu d’échanges grâce aux voies maritimes, espace de militarisation et de projection des puissances étatiques. L’étude des mers/océans reste donc d’un intérêt pertinent : certains États utilisent ces espaces comme une arme géopolitique afin de renforcer leur poids économique et militaire. À l’heure des discours musclés de Vladimir Poutine concernant l’Arctique ou des activités militaires de la République populaire de Chine (RPC) en mer de Chine, il serait donc pertinent d’étudier ces cas particuliers. Le concept de « territorialisation » des espaces maritimes pourrait prendre sens. Cependant, doit-on réellement redouter une tentative d’appropriation juridique et physique des mers et des océans face aux ambitions géopolitiques des États ?
Que sont les espaces maritimes ?
Les espaces maritimes couvrent 71 % de la planète Terre, ce qui équivaut à 361 millions de km². Depuis des siècles, les mers possèdent un rôle majeur : zone de transit permettant l’expansion du commerce entre les nations, réservoir de ressources vivrières. Ainsi, la principale caractéristique de la mer est d’être libre pour tous et pour toutes les nations.
Pour autant, depuis quelques décennies, les mers deviennent des espaces de convoitise : littoralisation massive, développement de façades portuaires. Ce rôle croissant des mers fait suite au développement de la mondialisation contemporaine marquée par une maritimisation. Désormais, il semblerait que les États accroissent leur projection de puissance, à savoir la défense de leurs intérêts, qu’ils soient militaires ou économiques.
Comment gérer ce rôle prédominant des espaces maritimes ?
Suite au développement massif des flux par voie maritime, les États ont défini des règles concernant les droits et compétences qu’ils peuvent exercer sur ces mers. Pour cela, la convention de Montego Bay en 1982, aussi appelée Convention des Nations unies sur le droit de la mer, constitue le socle des États quant à l’exploitation des mers. Cette convention donne des prérogatives particulières aux États par le biais de la distinction de cinq espaces maritimes.
Parmi celles-ci, trois concernent les eaux intérieures, la mer territoriale et la zone contiguë, en appliquant des droits régaliens plutôt classiques. En revanche, ce qui est nouveau est la définition d’une Zone économique exclusive (ZEE) et du plateau continental étendu. Ces espaces permettent l’introduction de nouveaux droits grâce auxquels les États peuvent exercer leur souveraineté ou disposer de compétences fonctionnelles. Ce sont des droits économiques concernant la recherche, la gestion, l’exploration et l’exploitation de ressources naturelles.
Quels sont les défis et les dynamiques géopolitiques aujourd’hui ?
De nos jours, la mer revêt trois aspects fondamentaux : un espace riche, comprenant des voies de communication et permettant la projection de la puissance. Or, avec la mise en place de nouvelles activités marines, un certain déséquilibre s’affirme. On pourrait alors redouter une certaine territorialisation des mers/océans. Plus concrètement, plus l’État agit sur les mers en développant de nouvelles activités, plus il projette sa puissance et plus il tend à se protéger et à militariser cet espace.
On peut néanmoins remarquer qu’il n’existe pas de gouvernance mondiale à cette effigie pour pallier les nouveaux enjeux et défis maritimes, hormis la Convention de Montego Bay. Aucune instance internationale n’est capable de régler ces différends qui deviennent pourtant un enjeu déterminant dans les relations internationales.
Mais comment définir un territoire et le processus de territorialisation ?
La territorialisation peut se résumer à trois aspects : présence d’un territoire avec frontières, approprié par un État ou une entité, avec une volonté d’utilisation ou d’accaparement de ressources situées sur ce territoire. L’existence d’un territoire suppose au préalable l’exercice d’une autorité.
La territorialisation est donc un processus qui permet d’implanter des frontières sur un espace pour avoir accès et utiliser ses ressources. À cet égard, plusieurs situations semblent correspondre à cette définition. Prenons le cas de deux exemples : la mer de Chine méridionale et l’océan Arctique.
La mer de Chine méridionale
La mer de Chine est en effet un espace disposant de nombreuses ressources. Ceci suscite donc de vives tensions entre États riverains, particulièrement en raison de la République populaire de Chine. De son point de vue, cet espace est approprié ou, tout du moins, demeure appropriable. La Chine, de son plein gré, revendique un territoire bien délimité : celui de la ligne en neuf traits.
En rejetant les droits des pays riverains et en dévoilant sa propre conception des droits maritimes, la Chine soutient l’appropriation d’un gigantesque territoire. Celui-ci comprend des îles comme les îles Spratleys ou Paracels.
Comment la Chine s’affirme-t-elle ?
Pour commencer, la Chine mise sur sa stratégie militaire en développant son « collier de perles ». Celui -ci se caractérise par des points d’appui (ports) et le développement d’une flotte navale. Pour accroître sa présence dans la mer, la Chine développe la « stratégie de la grande muraille de sable ». Il s’agit de la rénovation d’îlots et de bases, et la création d’îles artificielles pour assurer une présence militaire.
La question de l’Arctique
La question de l’Arctique est un exemple pertinent de conflits entre États amenant à une certaine volonté de territorialisation. L’Arctique est tout d’abord un espace de plus de 20 millions de km² comprenant un océan avec des littoraux complexes.
Dans un contexte de dérèglement climatique, l’Arctique devient un enjeu géopolitique majeur pour les États. Ses États riverains, voire non riverains, tels que la Russie, le Canada, la Norvège ou encore les États-Unis, se lancent dans des revendications territoriales au-delà de leurs ZEE respectives. On assiste sans aucun doute à une territorialisation de l’océan. Chaque pays revendique ce qu’il peut, même les plateaux continentaux ou eaux internationales, pourtant désignés « bien commun de l’humanité ».
Pourquoi un tel engouement ?
La région arctique se réchauffe deux à quatre fois plus vite que le reste du monde. Elle pourrait donc devenir une route commerciale majeure et un lieu d’approvisionnement de matières premières. Dans un contexte où la mondialisation cherche la rapidité, l’efficacité et l’utilisation de nouvelles technologies, il est incontestable que l’Arctique devienne le centre de l’attention. Michel Foucher, dans son ouvrage L’Arctique : la nouvelle frontière, montre bien cette dynamique.
En dévoilant les nouveaux fantasmes géopolitiques et économiques autour des ressources et des opportunités dans la région arctique, Michel Foucher affirme que le réchauffement climatique dévoile une « nouvelle frontière de l’offshore » (13 % des réserves mondiales de pétrole). Une nouvelle frontière du commerce maritime mondial se dessinerait. Plus encore, une nouvelle frontière juridique apparaîtrait puisque cette région suscite la convoitise des États riverains et non riverains.
Comment s’affirme cette volonté de puissance ?
Avec cette dislocation de l’Arctique, il semblerait que la puissance russe fasse son retour avec de nouvelles stratégies. Depuis le début du XXIᵉ siècle, les autorités russes ont développé un programme d’aménagement maritime. Il se déploierait le long de la côte sibérienne, entre le détroit de Béring et la Norvège, pour déployer cette nouvelle voie commerciale. D’autre part, de nouvelles infrastructures gazières et pétrolières font leur apparition. C’est le cas du projet « Yamal LNG », ayant pour but d’extraire du gaz naturel de la péninsule du Yamal.
Bonus
Plus généralement, sur le thème des mers/océans, certaines références de géopoliticiens sont incontournables dans une copie. Parmi celles-ci, la théorie du Rimland, au début du XXᵉ siècle, de Nicolas Spykman, qui affirme la nécessité de contrôler les contours maritimes du littoral européen pour assurer une stabilité mondiale.
Plus tôt encore, en 1890, Alfred T. Mahan insistait sur la nécessité pour les États-Unis de mettre en place une marine puissante. On remarque que le fait maritime est un débat ancien qui mérite d’être pris en compte dans la quête de puissance étatique.
Si tu veux en savoir plus sur d’autres espaces maritimes, n’hésite pas à consulter cet article sur la mer Méditerranée. En ce qui concerne la Chine et sa quête de puissance maritime, des articles plus approfondis comme sur le transport maritime ou sur la guerre commerciale avec les EU te seront très utiles !